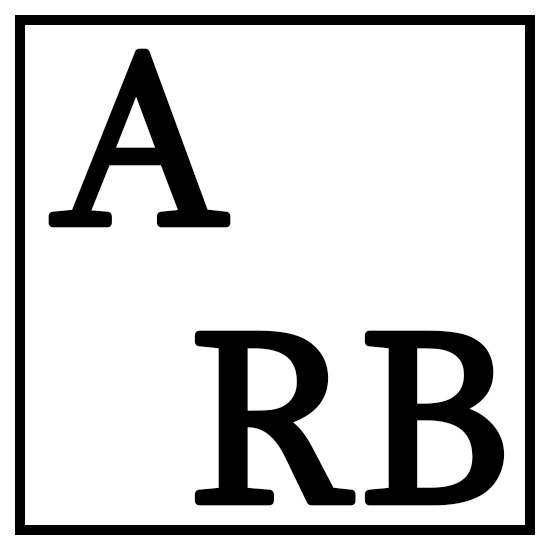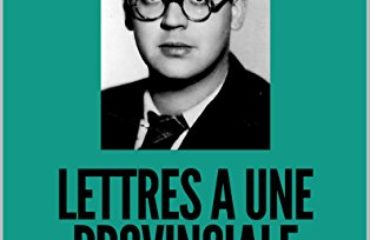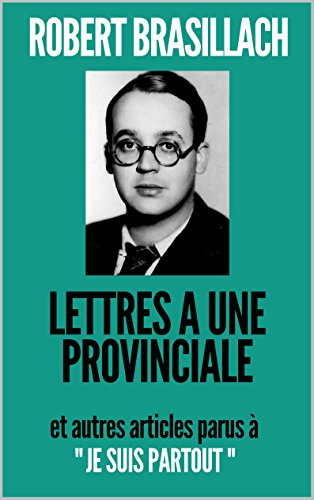
C’est au théâtre, l’autre soir, ma chère Angèle, que j’ai le mieux compris certaine étonnante équivoque qui domine notre temps, et à laquelle, si vous le voulez bien, nous donnerons le nom très grave d’équivoque de la liberté. Les Pitoëff jouaient une pièce de Léo Ferrero, le jeune écrivain, fils de l’historien, mort tragiquement il y a peu d’années. Vous savez que j’ai beaucoup d’amour pour les Pitoëff, et, si vous venez à Paris, je vous conseille d’aller contempler, au troisième acte, l’apparition légère, aérienne, de Ludmilla en robe blanche. C’est un oiseau qui survole la scène, quelque chose d’ironique, d’impalpable et de ravissant. Mais peut-être, comme moi, serez-vous aussi fort intéressée par la manière dont l’honnête public comprend la pièce. On m’avait dit qu’Angelica, farce idéologique qui fait des personnages de la comédie italienne les symboles de notre temps, était une pièce antifasciste. A dire vrai, la fantaisie y déguise si bien l’idée que nous sommes loin de lui donner un sens trop précis. Mais ce dont je suis bien certain, c’est que les applaudissements qui soulignaient certaines tirades et certains mots ne venaient point d’antifascistes. Lorsqu’on entend, ma chère Angèle, revendiquer pour la liberté, lorsqu’on entend dire que le socialisme est le plus sûr moyen de devenir ministre, qu’un pays soumis au régime de la délation et à la dictature d’une sorte de Tchéka est un pays où l’on n’aime pas vivre ; lorsqu’on entend réclamer le droit de réunion, moquer la manière de préparer des élections, je ne suis pas sûr – n’en déplaise à la charmante mémoire de Léo Ferrero – qu’on ne pense pas tout d’abord à M. Blum, et puis un peu à M. Staline.
La semaine où l’on jouait cette pièce, on interdisait une réunion de M. Doriot à Montpellier et une réunion du Rassemblement antisoviétique à Amiens. Cependant, à Paris, au Vélodrome d’Hiver, des révolutionnaires voyageurs venaient réclamer des canons pour l’Espagne. Il y a des gens qui se disent Espagnols et qui ne sont pas du tout Espagnols : l’un d’eux se nommait Gorkin, et, le lendemain, il se voyait interdire l’entrée de l’Angleterre. Mais la France l’avait accueilli, au nom de la paix et de la liberté.
Est-ce qu’une telle équivoque, ma chère Angèle, prend toujours en province ? A Paris, l’accueil fait à Angelica, entre autres signes, me prouverait aisément le contraire. De bonne foi, les spectateurs, devant cet anarchisme de poète, paré de couleurs vives, croyaient à une défense juvénile de leurs libertés, et ces libertés ne sont point menacées, ici, par le fascisme. Les journaux russes de langue française peuvent vivre de cette équivoque ils ont pu organiser leur affaire avec une méthode admirable ; André Chamson peut aller passer son congé payé en U.R.S.S., et Clara Malraux en Espagne ; Martin-Chauffier, enlevé à Finaly et aux curés, avec vingt francs de plus par mois et une sortie supplémentaire le samedi soir pour faire l’amour, peut balayer avec allégresse les escaliers de Vendredi, en gilet rayé, et sifflant l’Internationale : tous ces personnages ne réussiront pas tout à fait à nous convaincre qu’ils luttent pour la liberté. Par quelle aberration, par quelle inconséquence l’espèrent-ils ? Par quelle aberration (ou quelle secrète bravade, quel secret sadisme) M. Blum prétend-il que la loi sur la presse qu’il prépare ne tend qu’à mieux sauvegarder la liberté ? Il faut croire que le pouvoir de certains mots est encore grand, puisqu’on n’ose pas le braver tout à fait. Il y eut une époque, ma chère Angèle, où les communistes ne parlaient pas de liberté, où ils prétendaient établir la dictature du prolétariat, où ils citaient les phrases si dures de leurs maîtres, Karl Marx ou Lénine, contre le socialisme français, socialisme de rêveurs et de petits bourgeois, et contre les dogmes de la révolution sentimentale. Il est vrai que c’était aussi le temps où ils traitaient Léon Blum d’oustricard, et où M. Jouhaux était un profiteur.
J’avoue que j’aimais mieux cette attitude. Il faut supposer qu’elle n’était pas extrêmement politique, et le Français aime toujours à croire, comme Bartoldi, que la Liberté éclaire le monde. Par malheur, je ne pense pas qu’on puisse tenir longtemps contre l’évidence. Patiemment, sûrement, le parti communiste prépare la guerre, et il est difficile de ne pas s’en apercevoir. Patiemment, sûrement, le gouvernement socialiste cherche à supprimer les libertés, et le déguisement de cette tentative est encore plus difficile. La guerre et l’esclavage, il me semble que ce sont deux thèmes excellents, et que nous pourrons les dénoncer chaque jour, malgré les agents de l’étranger et l’intelligentsia-service de M. Chamson. La malhonnêteté intellectuelle, que les décrotteurs de chaussures de M. Blum ont élevée à la hauteur d’une profession lucrative, ne suffira sans doute pas à nous faire croire que la paix et les libertés sont soutenues par des policiers provocateurs et par des espions. Les vieux libéraux naïfs, comme Miguel de Unamuno, s’en sont déjà rendu compte en Espagne. Peut-être leurs cousins de France seront-ils éclairés un jour. Une soirée de théâtre parisien peut servir à prouver que l’équivoque de la liberté est une farce à laquelle on ne croit plus, et que le rempart des anarchies nécessaires n’est pas la muraille du Kremlin.
Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 31 octobre 1936