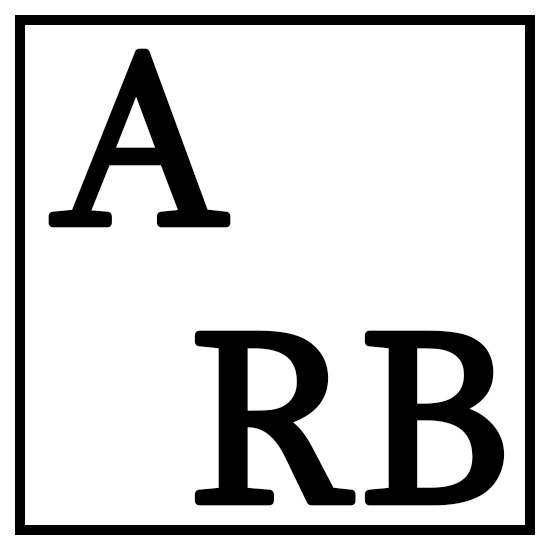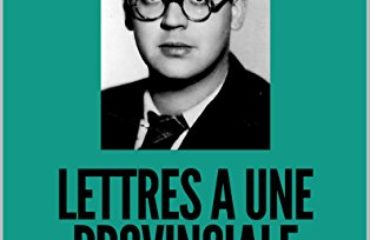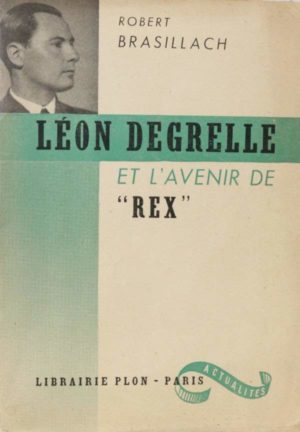
Tout naturellement, c’est d’abord de la personne du chef que la légende s’est emparée. Il est jeune, et les hommes vous disent avec un peu d’ironie : « Les femmes aiment beaucoup Léon Degrelle. Elles le trouvent si beau ! » Mais les rexistes eux-mêmes en plaisantent et ils ont fait à ce sujet un affreux jeu de mots, qui est tout à fait dans leur manière : « C’est, disent-ils, ce que nous nommons le Rex-Appeal. » On lui prête des sentiments contradictoires, on le dépeint comme un futur Hitler, alors qu’il se défend d’aspirer à la dictature, on l’accuse de gallophobie et on vous explique qu’il n’est même pas Belge, que toute sa famille est française, on lui invente un passé rocambolesque où il aurait été tour à tour, en Amérique, vagabond, soutier, boxeur peut-être gangster. Tout cela est à peu près inévitable.
J’aime mieux pourtant la vérité et cela d’autant plus que j’évoquerai longtemps, je suppose, cette nuit en automobile, sur la route de Namur à Bruxelles, dans les bois mouillés, où Léon Degrelle, au retour d’une réunion, me racontait sans ordre, avec cette fraîcheur immédiate, cette poésie extraordinaire qui se dégage de ses moindres mots, son enfance paysanne de dénicheur d’oiseaux et de petit garçon en sabots, voleur de pommes.
Il est né à Bouillon, dans les Ardennes belges, le 15 juin 1906 dans une famille qui devait compter en tout huit enfants. Dans la famille de sa mère on avait longtemps été médecin de père en fils.
J’ai bien connu mon grand-père, me dit Léon Degrelle. J’avais huit ans quand il est mort. C’était un homme de là-bas, vous savez, un pays âpre l’hiver, pauvre, où les sens vivent rudement. Il partait à cheval, dans la nuit, pour faire ses visites aux malades, comme l’avaient fait son père, son grand-père. Une nuit, on l’a appelé pour une pauvre femme qui attendait un bébé, et qui en avait déjà six, et qui ne savait pas comment elle nourrirait celui-là. Et voilà qu’elle a deux jumeaux, et rien pour celui qu’on n’attendait pas, même pas de quoi le coucher. Alors mon grand-père est revenu chez lui, à Bouillon. Il a pris sa petite fille qui dormait dans le berceau, un grand berceau à la mode ancienne, très haut, en bois courbé. Il a mis sa petite dans le lit de ma grand’mère, il a flanqué le grand diable de berceau en travers de son cheval, et il est reparti, à trente kilomètres de là, pour donner à la bonne femme le berceau de sa petite fille. Je le vois encore, avec ses grandes moustaches, quand il allait organiser des réunions catholiques. Il était le chef des catholiques du pays, et à un moment où c’était plus désintéressé et plus grave qu’aujourd’hui, je vous assure. C’était cela, la famille de ma mère.
Puis, de sa voix un peu assourdie par les grands efforts oratoires, cette voix que j’entends sans voir le visage, parmi le vent de la vitesse le glissement de la voiture, la pluie contre les vitres, il me parle de sa famille paternelle :
– Toute la famille de mon père est originaire de Solre-le-Château, près de Maubeuge. Au petit cimetière sont enterrés tous les miens. Il y a eu plusieurs branches, qui portent des noms différents, unis au nom de Degrelle : certains (j’ai un cousin de ce nom qui tient encore un café dans la région) s’appellent même Degrelle-Degrelle, pour les distinguer des autres. Nous avons été une famille extrêmement nombreuse : en quatre cents ans, il est né, il a vécu, sans compter les enfants morts en bas âge, deux cent quatre-vingt-huit Degrelle. Tout cela est inscrit sur notre livre de raison, que je possède encore. On y marquait les naissances, la raison pour laquelle on avait donné tel nom aux enfants, et comment étaient morts les vieux. J’ai eu un ancêtre tué à Austerlitz, et ce jour-là, il lui naissait une fille, et on l’a appelée Souffrance. Une autre, née au moment des guerres de Napoléon elle aussi, s’est appelée Victoire. Pendant quatre cents ans, des paysans appelés Degrelle ont cultivé le même champ. Dans le livre de raison, on a aussi gardé les lettres d’amour du fiancé à la fiancée. En même temps que de leur amour, ils se donnent des nouvelles du temps, de la récolte, ils disent : le blé, ou le seigle, seront bons cette année. Je pense, voyez-vous, qu’en France, au temps des rois, il y avait des millions de familles qui étaient pareilles à la mienne : et c’est pour cela que la France était un grand pays. Quand le redeviendra-t-elle?
Il se tait un instant pendant que la pluie redouble au dehors.
– C’est de là que Rex est né, il ne faut pas en douter. C’est cela que je veux refaire, et recréer. Vous savez la devise de notre famille. Nous étions presque tous maigres et petits, chétifs, grêles. Et notre devise était : « Grêle est, mais croîtra. »
Il réfléchit sans doute au destin, au hasard, qui a fait de ce Français, si profondément enraciné dans ses traditions provinciales, un Belge.
– Trois kilomètres de plus ou de moins… Maintenant, mon sort est fixé. Né en France, J’aurais joué un rôle de Français, avec la même ardeur. Je suis Belge, je fais mon devoir de Belge.
C’est avec les mêmes mots, si simples, qu’il me parle de son enfance paysanne. A la suite des lois antireligieuses, son père, catholique convaincu, était venu s’établir à Bouillon comme brasseur. Je revois, tandis qu’il me parle, cette petite ville de trois mille habitants, si près de la frontière française, et qui, jadis, ne forma qu’un pays avec notre Sedan. C’est l’un des joyaux des Ardennes, avec son pont brun et courbé sur la Semois, sa rivière encaissée, son château qui domine la ville, et surtout ses bois proches, et la merveilleuse douceur de ses collines, de sa lumière.
– Mettez-moi à vingt kilomètres de Bouillon, dans les bois, me dit Léon Degrelle. Je reconnaîtrai mon chemin les yeux fermés.
Par un étrange miracle, ces Ardennes évoquent la Savoie au printemps, le Jura, la Cerdagne française. C’est la même mesure des collines boisées, le même éclat transparent du ciel, la même fraîcheur des eaux vives.
– Enfants, nous voyions descendre les trains de bois, liés ensemble, sur la Semois. La grande merveille, c’était l’hiver. Il nous amenait des troncs d’arbre, des sapins, de la glace, et, quelquefois, un énorme sanglier, tout gonflé et tout emmêlé d’herbes, qui s’arrêtait contre les piles du pont.
Puis venait le printemps. Les garçons couraient sur les pentes, cherchaient les oeufs à dénicher.
Nous regardions les jeunes pins. Dans les vieux pins, les oiseaux ne se mettent pas. Pendant des heures, il fallait attendre pour voir la mère s’approcher du jeune arbre. Alors, nous grimpions, et nous trouvions le nid. On mangeait les oeufs tout chauds. Ou bien, on allait voler des pommes. Mon père aussi avait des pommes : mais les pommes volées ont un goût tellement meilleur !
Et Léon Degrelle ajoute :
– Voyez-vous, jamais je n’oublierai ces instants-là. Personne ne peut s’amuser autant que nous nous sommes amusés, moi et mes frères ou mes soeurs. Songez à ce qu’était une fête pour nous. Nous allions attendre les voitures des forains en haut de la côte, à quatre, cinq kilomètres de là. Le premier jour de la fête, on nous donnait un franc, le second jour dix sous, le troisième cinq sous. Je n’ai jamais été aussi riche, je n’ai jamais été plus heureux.
C’est là que le petit garçon a appris beaucoup de choses, et qu’il s’est formé.
– Je jouais avec les autres enfants du village. Nous étions tous pareils. Vous savez qu’en Wallonie, on met souvent l’adjectif devant le nom, à l’ancienne mode : on dit une dure vie, le blanc pain, le noir café. Chez nous il y avait surtout du noir pain, et pas toujours de café. Mais tout le monde s’aimait. Mon père était un bourgeois, et le notaire, ou le médecin étaient des bourgeois. Mais ils saluaient en passant devant leur porte le forgeron et le tanneur, parce que le forgeron et le tanneur, comme eux, gagnaient leur vie, et avaient beaucoup d’enfants, ils étaient honnêtes et travailleurs. D’ailleurs tout le monde avait beaucoup d’enfants chez nous nous étions huit, et onze dans la famille de mon père, et dix dans celle de ma mère, et douze chez le notaire, et sept chez le médecin. Vous savez, on n’est jamais bien riche quand on a tant d’enfants à élever, et c’est cela qui est bien. Alors, l’ouvrier pense que son patron remplit son devoir. Alors, on le respecte. Et un deuil est un deuil pour tous. Regardez les grandes villes. Quand quelqu’un meurt, ses voisins ne le savent même pas. A Bouillon, tout le village était en deuil quand quelqu’un mourait. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. C’est chez moi que j’ai appris la communauté sociale, la communauté d’un peuple.
Je m’en voudrais d’interrompre ce jeune chef, si sensible à tout ce qui l’entoure et qui le soutient, lorsqu’il évoque les démons de son enfance.
– Et imaginez la guerre par là-dessus. Imaginez combien cette communion de tout un village a été grandie par la guerre, par les privations, la haine de l’envahisseur. Nous mangions de la viande une fois par semaine, on fusillait nos parents et nos amis à Louvain, à Dinant, on déportait ceux qui ne plaisaient pas. Nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Déjà, il faut penser qu’avant la guerre, beaucoup d’habitants de Bouillon n’avaient jamais quitté leur ville, ou la vallée de la Semois. Il fallait être mon grand-père le médecin, mon père le brasseur pour aller visiter des malades assez loin ou livrer de la bière. Quelques-uns s’en allaient à pied, à Namur, à Liège, un jambon pendu à chaque épaule, pour le vendre au marché. J’ai vu cela : ils faisaient cent cinquante kilomètres ou plus, en trois jours, sans voiture, sans cheval, comme les pèlerins. Mais d’autres ne sortaient pas de leur maison. Au bas de la côte, il y a un endroit qu’on appelle le Point du Jour, parce que c’est là que le soleil se lève. Et le haut de la côte porte un nom magnifique : c’est le Terme. Au delà il n’y a plus rien. Je me souviens que j’étais tout enfant quand on a organisé à Bouillon une course de bicyclettes. Je n’avais jamais vu cela. J’ai suivi les coureurs, et je suis allé jusqu’au Terme. Là j’ai découvert, avec une surprise immense, que la route continuait, que le monde continuait, qu’il n’était pas borné à Bouillon. Je n’ai jamais été aussi stupéfait. Eh bien ! c’est cette côte, c’est ce Terme que nous avons guetté pendant quatre ans, eu attendant les soldats français qui viendraient nous délivrer. Et un beau jour nous avons vu arriver… les Américains. Nous n’avons rien compris : peut-être même a-t-on eu peur de nous voir leur faire un mauvais parti, puisqu’on les a tout de suite fait passer par une autre route. Mais vous comprenez ce qu’a représenté pour nous la côte.
Pour le petit garçon, qui grandissait, pareil aux autres petits garçons du village, dans l’hiver rude, le printemps pluvieux, quels discours admirables tenaient, sans paroles, ces bois mouillés, ces odeurs de pins et de prairies, ces champs de seigle, ces pierres usées par la Semois ? Plus tard, il s’en souviendrait lorsqu’il désirerait régénérer sa patrie et le monde – par un retour aux vertus terriennes, et à l’enfance.
– J’ai besoin de la fraîcheur, répète-t-il avec passion, j’ai besoin de l’enfance. Sans l’enfance, je ne suis rien.
Mais, dès son enfance, quand son père lui demandait :
– Que veux-tu être ?
Il répondait :
– Premier ministre !
Et l’on riait, sans doute, en évoquant le « Grêle est, mais croîtra », de sa famille.
Ainsi passaient les jours, dans ce pays d’Ardenne plein de bois, d’eaux vives, où l’on s’attend, chaque soir, à entendre sonner au loin les cors, à voir passer les chasses de Comme il vous plaira. Shakespeare et Ronsard y ont écouté les fées, placé leurs dialogues précieux, encore tout mouillés de la rosée matinale. De cette ancienne ville souveraine partit un jour, sur un pont tout pareil à celui qui se courbe encore sur la Semois, le plus illustre des princes du pays, Godefroy de Bouillon. Il entraînait avec lui vingt peuples pour la délivrance de la première paroisse de la chrétienté, la paroisse où est mort le Christ. C’est là qu’un petit garçon qui jouait avec d’autres enfants, fils du formon ou fils de l’ouvrier tanneur, apprenait, mieux que dans les livres, la grandeur du pays où il était né, et l’amour.
Après la guerre, en âge de faire des études, Léon Degrelle passa trois ans chez les Jésuites de Namur.
– Ce sont de rudes formeurs d’hommes, dit-il volontiers.
Il leur rend d’autant mieux hommage qu’il en a parmi ses parents, comme il a des religieuses, des Pères blancs, suivant l’ancienne coutume catholique des vastes familles. Puis, il passa à Louvain, la vieille université belge, afin d’y poursuivre des études de droit, qu’il devait mener jusqu’au doctorat exclusivement. Et de Louvain, il ne cessera jamais de parler avec amitié.
Là aussi, et mieux que de la côte de Bouillon, il faisait la connaissance d’un monde nouveau, avec ses lois, ses espérances, ses travaux et ses jeux. Ce furent quelques années d’une grande importance, où il groupait au tour de lui ces amitiés sans lesquelles il n’est peut-être pas d’apprentissage dans l’art de conduire les hommes. « On ne nous refera plus une vie pareille, » dit-il lui-même aujourd’hui en songeant à ces heures si proches, à la joie de vivre, aux plaisirs simples, aux querelles et à la fraîcheur de la jeunesse. C’est là, sans doute, qu’il apprit pour la première fois à connaître son pouvoir.
A son sujet, Bertrand de Jouvenel évoquait un jour ces garçons autour de qui, dans les lycées et les collèges, on se range naturellement, qui font la loi dans la classe, que l’on aime et que l’on admire. Et, bien que la plupart du temps, ces admirations ne survivent pas à l’âge d’homme, il déclarait trouver en Léon Degrelle comme un souvenir du « dictateur des cours de récréation » qu’il avait dû être. Je ne pense pas qu’on doive se fâcher de ce mot, et Léon Degrelle moins que quiconque. Car il met bien l’accent sur la jeunesse extraordinaire de ce mouvement, et sur la vertu de cette jeunesse, malgré les railleries des gens de bon sens.
Il est aisé de voir que c’est à Louvain que s’est formé le dictateur des cours de récréation. Non que des préoccupations plus sérieuses n’aient pas, à cet instant, déjà conquis Léon Degrelle et ses amis. Mais on s’en voudrait d’oublier cette chaude atmosphère de gaieté, de brasseries, de chahuts d’étudiants, de passion joueuse, qui donne aux abstractions (la jeunesse aime toujours les abstractions) une telle couleur vivante.
Il s’amusa beaucoup. « En un siècle où on ne sait plus rire, avoue-t-il franchement, nous avons ri. » Et d’ajouter avec gravité : « La farce est un apostolat. La farce est une école. On y apprend à être inventif, décidé. » Qui sait si la farce, après tout, n’est pas une excellente préparation politique ? Au moins enseigne-t-elle le mépris des conformismes, sans lequel je ne crois pas qu’on puisse jamais rien faire de bon.
Lui-même a raconté quelques-unes de ses farces, qui rendirent célèbres, aux environs de 1927, les étudiants de Louvain et, parmi eux, Léon Degrelle. Sans doute, quand les Soviets organisaient une exposition de propagande, et que les jeunes gens, en deux minutes et demie, fracassaient le buste de Lénine et mettaient à mal les plus vénérables spécimens de l’art soviétique, les communistes et les libéraux protestaient-ils, mais les rieurs étaient pour les iconoclastes. Ils étaient aussi pour eux quand ils chahutaient les conférences du R. P. Hénusse sur les crimes passionnels, étrange sujet pour un ecclésiastique, ou bien lorsque avec un luxe de détails précis ils faisaient arrêter un grave rédacteur de revue par la police secrète. Mais leur célébrité faillit devenir européenne lorsqu’ils inventèrent l’admirable procès des héritiers de Dumas fils.
Ils publiaient dans leur journal l’Avant-Garde un feuilleton funambulesque, la Barbe ensanglantée, « grand roman d’aventures académiques en vingt épisodes, authentique, véridique et réel ». C’était au mois d’octobre 1928. Sans doute, le procureur du roi, M. Herriot en personne, « la sémillante Mme Machin » et plusieurs professeurs distingués se trouvaient- ils mêlés à des bouffonneries assez grosses, mais l’ensemble paraissait plutôt laborieux. Pourtant, l’oeuvre était signée Alexandre Dumas petit-fils, et cette signature apocryphe donna soudain aux étudiants l’idée de soutenir l’attention un peu défaillante des lecteurs par un coup de maître.
Ils imaginèrent une protestation des héritiers de Dumas. Ils firent imprimer un papier à en-tête de Me Henry Torrès qu’ils domicilièrent à Paris, rue de Carpentras, et se firent adresser une lettre pleine de véhémence. « Sous prétexte de rigoler et de zwanzer, comme vous dites dans votre jargon belge, leur déclarait l’éminent avocat, vous. portez atteinte à la propriété littéraire… Vous vous permettez de mettre en mauvaise posture certaines personnes fort connues et universellement appréciées… Vous vous en prenez à un procureur du roi, à un commissaire de police, au prestige d’un ministrefrançais, M. Herriot à un savant distingue, à des professeurs éminents, et jusqu’à une femme. Lefait que vous la désignez sous le nom équivoque de Mme Machin indique qu’il s’agit là d’une personne de haute qualité. » Aie Torrès déclarait qu’il allait faire poursuivre en justice l’Avant-Garde au nom des héritiers Dumas. Les juristes de la Faculté eurent tôt fait de rédiger un projet d’assignation, plein de majesté, au nom de la branche masculine des Dumas domiciliée à Paris et de la branche féminine, les dames Plancheville nées Dumas, domiciliées à Angoulême. Un étudiant, Jean Carton de Wiart, se disant envoyé par Me Torrès, alla trouver un véritable huissier, qui, vite convaincu, fit inscrire l’affaire au tribunal et s’en vint remettre dès le lendemain à l’Avant- Garde une assignation authentique avec cachet, signature et timbre fiscal.
L’Avant-Garde publia le tout. Mais pour que la farce prît toute sa portée, il fallait saisir l’opinion. Une lettre déchirante fut adressée à tous les quotidiens belges, les suppliant de prendre le parti des étudiants dans une circonstance qui mettait en péril l’indépendance de la presse et les droits sacrés de l’humour. D’un bout à l’autre du pays, ce fut une levée de boucliers pour défendre les étudiants, attaqués pour une innocente plaisanterie. Les sceptiques avaient dû se rendre à l’évidence : l’affaire était bien inscrite à Louvain. En même temps l’orgueil national s’en mêlait. Léon Degrelle en personne dénonçait des manoeuvres politiques. Quel était ce Torrès qui se moquait des Belges et de leur jargon ? « Communiste millionnaire, prolétaire en limousine, avocat de toutes les causes sanglantes, … quel intérêt a donc ce professionnel de la comédie judiciaire à amorcer chez nous une propagande personnelle? » Le pays prenait fait et cause, avec « les gens d’ordre » contre l’agitateur bolcheviste.
Comme pourtant Nle Torrès ne pouvait venir plaider à Louvain, il lui fallait un remplaçant. On établit un dossier contenant copie de la lettre de l’avocat, de l’assignation, les numéros de l’Avant-Garde où étaient soulignés en rouge les passages les plus significatifs de la Barbe ensanglantée, et une lettre du prétendu représentant de Me Torrès. On envoya le tout à un députéavocat, Me Cleymans, en le priant d’agir à la place du’maître du barreau parisien. Me Cleymans n’hésita pas une seconde, il crut tout ce qu’on lui disait, et se déclara prêt à défendre les droits de MM. Dumas et des demoiselles Plancheville. Toutefois, comme il était catholique et craignait de se compromettre avec un homme de gauche comme Torrès, il pensa confier l’affaire à son premier stagiaire. On plaida, et le tribunal, devant la gravité des faits, remit le jugement à huitaine.
C’est alors, naturellement, que l’Avant-Garde révéla la farce, et donna tous les détails. Il n’y eut qu’un vaste éclat de rire dans toute la Belgique. Les chroniqueurs judiciaires, qui avaient été les premiers bernés, prirent l’aventure avec bonne humeur. Me Torrès lui-même, averti, envoya une lettre sympathique aux farceurs. Le député Cleymans n’osa pas bouger. Le président du tribunal était trop bon Belge pour poursuivre les étudiants pour outrage à la magistrature, et son indulgence lui valut une immense popularité. Quant au gouvernement, comme dit Léon Degrelle, il fut satisfait, puisque dans l’aventure, il avait gagné 2 fr. 50 en timbres fiscaux.
On aurait tort de ne pas comprendre le goût de l’amusement simple, de la joie, qui demeure une des vives séductions de Léon Degrelle. Les grandes farces de Louvain, sans doute, leur époque est passée, et des jeux plus graves retiennent l’attention. Mais il est assez bien, je l’avoue, que le jeune chef de Rex ait commencé par animer les jeunes étudiants, ait commencé par la gaieté.
En même temps, sans doute, il découvrait aussi autre chose. Il lisait les poètes, il les imitait, et il publiait même quelques vers, Tristesses d’hier ou ce recueil intitulé : Mon pays me fait mal.
dont le titre, aujourd’hui, semble prophétique. Enfin, il cherchait à connaître les systèmes et les hommes, et, comme la plupart de ses camarades, il était maurrassien endiablé. Même si plus tard, il devait chercher à côté des principes de l’Action française des lois et des règles de vie, il n’est pas malaisé de reconnaître tout ce que sa logique doit au maître politique de toute une jeunesse, et lui-même ne renie pas ses fidélités du passé. Il lui arrive de dire, un peu en plaisantant, si l’on plaisantait sur des sujets si graves:
– C’est moi qui ait fait condamner l’Action française.
En effet, en 1926, à Louvain, au cours d’une enquête sur les maîtres de la jeunesse catholique, les étudiants, dirigés par Léon Degrelle, désignèrent Maurras avec -un tel ensemble que les autorités spirituelles s’émurent. C’est des réponses de Louvain que sortit le réquisitoire de l’avocat Passelecq, qui fut pieusement recopié par l’archevêque de Bordeaux, et finalement la condamnation de l’Action française par Rome. Un des jeunes collaborateurs de Léon Degrelle, José Streel, écrivait un jour, évoquant « les combats cruels autour de Maurras », qu’ils avaient été « la première meurtrissure, l’apprentissage des drames spirituels, en attendant les autres », et ne craignait pas de reprendre le mot de Péguy, évoquant sa jeunesse dreyfusarde : Nous avons été grands.
Maurras condamné, les jeunes gens de Louvain et Léon Degrelle pensèrent qu’ils devaient d’abord essayer eux-mêmes de sauver leur pays et leur propre humanité. Ils purent ainsi dégager leur originalité, revenir aux sources de leur race, mais il serait vain de nier ce que doivent tous les jeunes de notre temps au plus incomparable des formateurs d’esprit, – ne serait-ce que cette critique de la démocratie, faite sans doute pour jamais.
Le monde se découvrait plus grand encore qu’il n’avait paru du haut de la côte, au sortir de BouilIon, et son Terme reculait de jour en jour. Léon Degrelle d’ailleurs apprenait à connaître à la fois 1a beauté matérielle et sa beauté spirituelle. Quand il en avait assez des livres, des luttes d’idées, des cours de droit et même des farces collectives, il partait, seul ou avec des amis, pour de longues promenades. C’est à bicyclette qu’il visita la Belgique, la Forêt-Noire, le nord de la France où vécurent les siens, la Touraine. Il y affermissait sa culture, par un regard vivant sur ce qui existe, et sur les charmes du passé. Dans les villes, il apprenait aussi à connaître des choses plus graves, plus importantes que les livres. Il apprenait à connaître l’existence de la misère. C’est de ce temps que date une enquête sur les Taudis, que le premier ministre Henri Jaspar admira fort et dont il félicita le jeune auteur. Déjà Léon Degrelle cherchait sur l’horizon autre chose que la littérature et ses plaisirs, et dénonçait les maux dont souffrent les hommes. Puis, toujours, il revenait à sa Wallonie natale, à la vallée argentée et verte de la Semois, et retrouvait aux vacances, avec la même amitié, son ami le forgeron ou son ami le bûcheron.
Parmi les réflexions du jeune Léon Degrelle sur la vie et sur les hommes, je crois qu’on ne se tromperait pas beaucoup en mettant au premier rang celles que lui inspira justement un de ses compatriotes wallons, le poète Louis Boumal. A peine âgé de vingt, ans, pendant un été qu’il passa en Touraine, Léon Degrelle écrivit une Méditation sur Louis Boumal, qu’il devait publier peu d’années après. Louis Boumal est un poète, dont la statue se trouve à Liège, et qui fut professeur quelques mois à Bouillon peu avant la guerre. Lorsque celle-ci éclata, il avait vingt-quatre ans. Il devait mourir en 1918, miné par la souffrance, à Bruges. Toute une jeunesse salua longtemps en lui quelqu’un qui aurait pu être un maître, et il ne faut pas douter que le destin de ce jeune aîné n’ait gravement touché Léon Degrelle.
Passionné de culture française, Louis Boumal cherchait à en suivre la tradition, comme il l’a dit lui-même, de Chrétien de Troyes à Maurras. Continuateur et restaurateur des anciennes fables, il trouvait dans sa Wallonie boisée et mystérieuse un accord entre la raison et les forces du sang et de la terre. Catholique, bien que le doute et le blasphème l’aient visité pendant la guerre, maurrassien, lecteur assidu de l’Action française, précurseur de la jeune école monarchiste, c’est une figure attachante et curieuse. Sous le ciel clair de Touraine, dans les jardins, le jeune homme qui se penchait passionnément sur ce destin trop tôt tranché, comment n’y aurait-il pas lu des leçons, des encouragements, comment n’aurait-il pas décelé dans cette sensibilité ouverte à toute chose, dans ce coeur déchiré par une foi inquiète, dans cet esprit acharné à construire sa patrie, une image différente, mais fraternelle, de sa propre jeunesse ? Il s’agissait alors de bien autre chose que de littérature, et Léon Degrelle pouvait se dire qu’un jour, en quelque manière, il réaliserait ce que la vie n’avait pas permis à Louis Boumal de réussir. Ainsi, au début des existences de chef, parfois le destin suspend-il quelque image votive, quelque reflet un peu frêle et prophétique de ce qui sera.
Aujourd’hui encore, de son petit livre, Léon Degrelle dira qu’il lui a été utile, et qu’il l’a aidé à comprendre « sa Wallonie latine ».
C’est ainsi qu’un jeune homme échappe aux livres, à l’intellectualisme. Non que l’intelligence soit inutile, et Léon Degrelle n’a pas le romantisme de la condamner. Mais il est beau que les livres et les méditations des poètes viennent compléter l’enseignement du sol, et que tout puisse s’unir dans une leçon vivante. Il est beau qu’un jeune homme cherche à travers l’intelligence à clarifier ce que lui a déjà murmuré son instinct, et que sa terre natale puisse lui apprendre aussi précisément l’amour et la force. Après Bouillon et après Louvain, on peut dire que Léon Degrelle a reconnu les voix qu’il écoutera désormais. Il lui manque pourtant une dernière expérience, décisive celle-là : l’expérience de la souffrance et de la grandeur, l’expérience du sacrifice pour une foi. C’est ce qu’il trouvera au Mexique.
La trégédie Mexicaine occupait depuis longtemps Léon Degrelle. Douze mille catholiques étaient tombés pour leur foi, sans que le monde civilisé s’émût, sous les coups de la plus atroce des persécutions, au milieu d’un raffinement inouï de tortures physiques et morales. Ce jeune homme de vingt-trois ans commençait à en avoir assez d’une vie facile et gaie, et même des soirs joyeux de Louvain, des farces ou des discussions politiques. Il voulait savoir comment étaient morts des hommes qui avaient une foi, – sa foi. Il décida de partir pour le Mexique.
Un journal bruxellois et un journal romain lui accordent, pour un reportage futur, une petite somme, à peine suffisante pour payer un passage d’émigrant, à fond de cale. Par malheur, Léon Degrelle a déjà écrit des articles extrêmement violents contre le gouvernement mexicain. Il ne peut partir sous son nom. Assez rapidement, il réussit à se procurer de faux papiers, qui le vieillissent de quelques années, et le présentent comme un jeune médecin. Un beau jour; il prend l’avion, atterrit à Hambourg, et s’y embarque pour Vera-Cruz.
C’est son premier grand voyage. Il l’accomplit dans un réduit de trois mètres sur deux, à fond de cale, où l’on a entassé six émigrants. Les machines font un vacarme effroyable. Il s’endort seulement au petit matin. Le steward allemand, qui l’a pris pour un Français, le réveille, et lui dit doucement :
– Monsieur, on voit votre patrie.
Pour lui faire plaisir, Léon Degrelle se lève et va regarder la France, dans la brume transpercée de faibles lumières. Il dit adieu à l’Europe qui, pour lui, était encore hier si douce et si calme.
Il arrive au Mexique au bout de trois semaines, après avoir cueilli des fleurs à Cuba, des pamplemousses, avoir dansé sur le pont, avoir passé des nuits à regarder l’eau, à écouter les musiques de fête. Comment cette nature chaude, ces nuits immenses, ne griseraient-elles pas le jeune aventurier ? Mais ce n’est pas pour cela qu’il est parti. La danse au clair de lune, le soleil doré, ce sont les charmes du voyage, cet entr’acte merveilleux de la vie : demain, il faudra savoir comment des hommes ont agi, et comment ils sont morts.
An Mexique il ne connaît personne. A un jeune catholique il a envoyé un câblogramme annonçant la venue d’un « amigo belga ». Il sait qu’on attend son arrivée, qu’on connaît son nom : mais comment trouver ceux qu’il cherche ? Et la police ne découvrira-t-elle pas que ses papiers sont faux ? Léon Degrelle est inquiet, et dit son chapelet dans le fond de sa poche. Il débarque pourtant à Vera-Cruz, il s’installe dans un hôtel modeste. On lui demande son nom. Il pense : de l’audace, encore de l’audace. Et il inscrit sur le registre : Danton.
Le lendemain, un jeune homme l’aborde dans la rue, lui montre, caché sous le revers de son veston, l’insigne de la jeunesse catholique mexicaine, une petite photographie découpée dans la prière d’insérer de son livre sur les Taudis, et lui demande à voix basse
– Vous êtes bien Léon Degrelle ?
Il le suit, emprunte un petit train invraisemblable, et, à Mexico, il est accueilli par les catholiques qu’il est venu voir, les Cristeros, les soldats du Christ.
C’est là qu’il passa quelques journées inoubliables, dans une villa pleine de roses et de jets d’eau. Le dimanche, un prêtre venait dire la messe dans le garage, il s’asseyait sur une chaise, et on se confessait l’un après l’autre, à genoux dans l’herbe. Puis, il consacrait l’hostie, donnait la communion, entre deux fûts de goudron, à des gens qui, peut-être demain, seraient tués. Il restait en habit laïc, et à la fin de la messe, il tendait aux assistants son stylographe, où l’encre était remplacée par l’eau bénite.
Pour tout le monde, Léon Degrelle est médecin, bien qu’il tienne volontiers des théories un peu ahurissantes sur l’origine du cancer et la guérison des maladies. Il visite le peuple, parcourt le pays. En décembre, il assiste aux neuf jours de fêtes qui précèdent la Noël, où l’on récite des prières pour demander aux maîtres de maison l’entrée pour saint Joseph et la Vierge Marie, où l’on organise des cavalcades, où l’on se livre à mille jeux naïfs, d’un paganisme touchant. Il n’oublie pas non plus d’aller voir les persécuteurs des catholiques, le président Calles, les bourreaux enrichis. Il veut contempler les résultats réels de cette immonde politique de « libération ».
Et toujours, il pense à cette épopée d’un peuple martyr, aux femmes et aux enfants imbibés d’essence, aux lignes télégraphiques d’où pendaient, en grappes, des dizaines de chrétiens, aux tortures. Quand l’Espagne, quelques années plus tard, retrouvera le secret de cette cruauté, Léon Degrelle pourra imaginer ce qu’elle est. Car il se souviendra des trente mille jeunes gens, étudiants, ouvriers, paysans, qui, un jour, ont pris le fusil pour defendre leur liberté et leur Dieu, des quatre mille jeunes filles qui assuraient le ravitaillement en munitions, des fusillés, des pendus, des déportés. Il se souviendra aussi, dans ce pays ruiné, d’où trois millions d’habitants s’étaient enfuis pour échapper au massacre et à la famine, du luxe scandaleux des révolutionnaires nantis. Ne nous étonnons pas si Léon Degrelle conclut, en évoquant ces souvenirs :
– Il paraît que c’est cela, la révolution. En tout cas, c’est ainsi qu’à Mexico les chefs rouges me l’ont montrée.
Deux ans avaient suffi aux chefs du Mexique pour détruire le catholicisme. Il n’existe plus dans le pays une école catholique, un seul ordre religieux, le port de l’habit est interdit, les prêtres « autorisés » (un par cinquante mille habitants) sont déchus de tous droits politiques et inscrits aux registres de la police, comme les filles publiques. Et pourtant, contre toute cette abjection, accomplie dans le silence de l’Europe, dans la froideur des États-Unis, contre les crimes et la honte, un peuple de martyrs s’était levé. Léon Degrelle, de l’Atlantique au Pacifique, fit le sombre pèlerinage du sacrifice des Cristeros, à travers quatre mille kilomètres de désert, évoquant ces trente mois de luttes, sans pain, sans armes et sans soutien, les messes de l’aube avec la communion donnée aux soldats, le drapeau orné de la croix, et pour finir, les milliers de tombes qui portent pour seule inscription : « Mort pour le Christ-Roi. »
– Tout cet héroïsme ne fut pas inutile, se disait-il. Il a sauvé l’honneur catholique.
Quand il n’amasse pas ses notes, ne cherche pas de tragiques documents, ou ne se cache pas d’une méfiante police, Léon Degrelle se livre à la beauté maléfique de ce pays. Avec des jeunes gens, des jeunes filles, il chante dans les pirogues, le dimanche, les chants mexicains qu’accompagne la guitare aiguë. Les dimanches du Mexique, les paysages désolés, et soudain les rivières rapides, les îles, les retours dans la nuit, les bras chargés de fleurs, sont parmi les plus beaux souvenirs de sa jeunesse. Il découvre les courses de taureaux, le soleil, la chaleur du nouvel an, les bains dans les lacs tièdes de janvier, et aussi les dieux étranges, le passé terrible d’un peuple toujours mystérieux. Seulement, à tout instant, une petite croix dans la campagne l’avertit qu’on s’est battu, il y a quelques semaines, et qu’on est mort.
Au bout de trois mois, il songe à quitter le Mexique. Il a tout vu, les tombes des martyrs et les palais des révolutionnaires, l’agonie du catholicisme et pourtant son printemps mystérieux, et aussi la parade marxiste, la faillite agraire et sociale. Dans une grande malle, il a soixantedouze kilos de documents.
Un soir, dans un salon, il fait la connaissance du directeur d’une revue américaine, lui raconte ce qu’il a vu. Le lendemain, on lui demande des articles : prix, dix-huit mille francs. Jamais de sa vie Léon Degrelle n’a vu autant d’argent ! Il décide de quitter Mexico et de gagner les ÉtatsUnis, où il découvrira vite un second journal.
Avant de partir, il assista à une réunion clandestine catholique. On l’emmena en pleine campagne, où s’étaient rassemblés des centaines d’hommes et de femmes. Ils lui offrirent des fleurs, des tapis, des plateaux de bois, des vases de terre cuite. Il leur parla. Peut-être était-ce la première fois que Léon Degrelle s’adressait à une foule. Ces Indiens aux pieds nus, qui ne comprenaient pas sa langue, écoulaient pourtant cet étrange jeune homme plein de feu. Et ils comprenaient, sans doute, au delà des paroles, ils comprenaient autre chose de plus mystérieux et de plus essentiel , puisque de grosses larmes coulaient sur leurs joues. Je ne crois pas que dans toute sa carrière oratoire, Léon Degrelle ait beaucoup de souvenirs qui lui soient plus chers.
Il eut beaucoup de mal à entrer aux EtatsUnis, où ses faux papiers lui jouèrent de mauvais tours, et, refoulé sur le territoire mexicain, il dut faire intervenir en sa faveur un évêque californien. Reçu enfin avec les honneurs de la guerre, il dépensa allégrement l’argent de ses reportages, visita à pied, ou à cheval, les États-Unis, le Canada, les Grands Lacs. Quand il rentra en Europe, après son expérience mexicaine, il était un homme, et savait ce qu’il voulait.
A Bouillon, Léon Degrelle avait appris les vertus paysannes, et avait pris contact avec son pays d’une manière vivante. A Louvain, l’avait appris le charme des amitiés intellectuelles, il avait commencé de raisonner sur l’univers, en même temps qu’il avait fait l’essai de son pouvoir d’animateur. Au Mexique, il avait appris comment des hommes se sacrifient, et il s’était juré que, dans toute la mesure de ses forces, jamais sa patrie ne connaîtrait les fautes et les crimes qui avaient ensanglanté ce sol étranger. Avant sa vingt-cinquième année, il revenait en Belgique fort de ces trois expériences capitales, et décidé à l’action. Le temps des jeux et des passions littéraires, même s’il semble s’y livrer encore, est terminé. Une autre aventure va commencer. Bientôt, le jeune écrivain, se souvenant toujours qu’il est poète, adressera à Notre-Dame-de-la-Sagesse une émouvante prière, qui est comme le testament spirituel de sa jeunesse :
Notre-Dame, je viens à Vous
Avec ma force, mon orgueil et mes sanglots,
Parce que mes vingt ans
Ont besoin de Votre Sagesse.
C’est Notre-Dame-de-la-Sagesse qui apprendra au jeune homme et à ses pareils le chemin qu’ils doivent suivre désormais :
Vous nous direz où doit passer la route
Et avec quels outils nos mains vont la tracer…
Notre idéal n’est pas demain mais chaque jour…
Comme un soldat qui marche au pas sur la chaussée,
Nous irons humblement apprendre le devoir…
Déjà, Léon Degrelle ne l’ignorait pas. Déjà, il avait commencé de construire cette route faite pour d’autres, où tant d’hommes, il l’espérait, allaient passer. Et désormais sa propre histoire va se confondre avec celle de son mouvement et de son parti.
Novembre 1936.
Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – Avant-propos
Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – I – La jeunesse de Léon Degrelle
Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – II – Qu’est-ce que le Rexisme
Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – III – Degrelle vivant
Robert Brasillach – Léon Degrelle et l’avenir de «REX» – Complet (PDF)