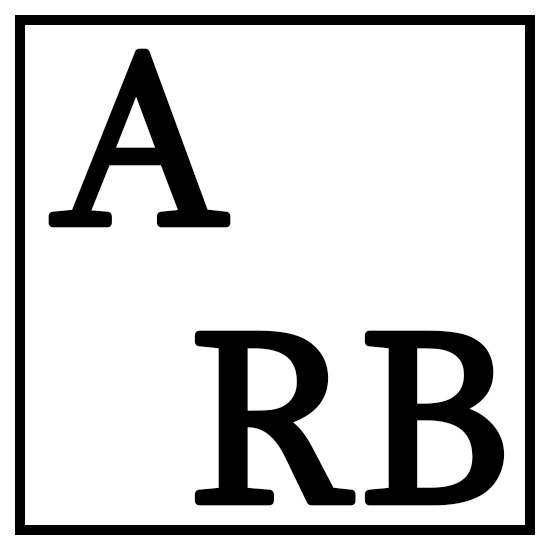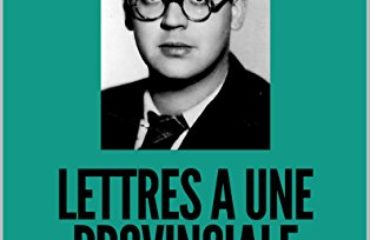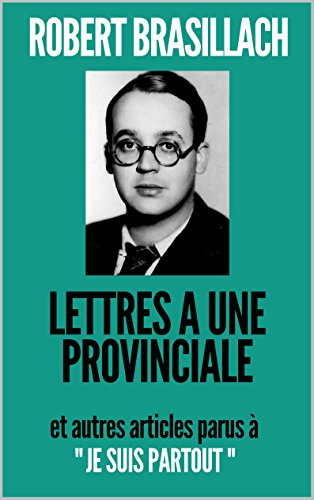
Oui, ma chère Angèle, les théâtres de Paris commencent à ouvrir leurs portes, et les cinémas en font autant. Mais, ces jours-ci, où la politique a tant d’importance, comment ne pas emmener ses préoccupations avec soi, même dans les salles de spectacle ? Aussi ne vous étonnerez-vous pas si le plus beau film de cette semaine, celui que vous devrez voir à tout prix, soit inspiré, lui aussi, par la politique. François Vinneuil, [ Pseudonyme de Lucien Rebatet pour sa chronique cinématographique dans Je Suis Partout. (note de l’édition) ] pour cette raison, me permettra de vous en parler.
Vous le savez, j’ai toujours une faiblesse pour les films russes. Le Cuirassé Potemkine, Tonnerre sur le Mexique m’ont toujours paru des oeuvres magnifiques, dont nos vaudevilles et nos drames mondains, hélas ! sont bien loin. Je me suis pourtant fait injurier par des camarades hirsutes lorsque j’ai contemplé Les Marins de Cronstadt dont on vous a parlé ici, et qui paraissent empreints du militarisme cocardier le plus repoussant. J’ai même murmuré : « Mais c’est du Déroulède ! » A quoi un tovaritch placé près de moi répliqua d’un ton mi-furieux, mi-émerveillé : « Si Déroulède est comme ça, Déroulède est très bien ! » Et je n’eus plus qu’à admirer combien nos communistes sont prompts à applaudir quand on leur montre comment se défend la patrie russe, eux qui siffleraient un soldat français à Verdun.
Toutefois, je dois dire que le film que j’ai vu me parait dépasser, et de beaucoup, Les Marins de Cronstadt en vertus héroïques. J’ai contemplé, sur l’écran magique, cette ville d’ocre et de soleil que je connais bien, ses ruelles étouffées, ses grilles forgées, ses portes barbares. J’ai revu, en quelques images prestigieuses, la place aux cent balcons, éclatante sous la lumière, et j’ai revu, dressé au-dessus du fleuve profond et vert, tout cet entassement de maisons, d’églises et de forteresses. Aussi vite, aussi magistralement qu’Eisenstein résume l’Espagne au début de Tonnerre sur le Mexique, le metteur en scène inconnu résumait la grandeur âpre d’une cité éternelle. Puis le drame commençait. Sous les attaques incessantes, sous l’éclatement gris des bombes, le sec halètement des mitrailleuses, des jeunes gens pâles et mal rasés, des enfants encore, défendaient pied à pied une citadelle déjà croulante. Bientôt, il ne reste plus qu’une tour carrée. La dynamite l’emporte. La troupe décimée se réfugie dans les souterrains. Et ce sont ces épisodes cruels et prodigieux, que seul peut inventer un metteur en scène de génie, ces épisodes qui donnent un sens et un élan au drame, et l’empêchent de ressembler à un simple documentaire : le feu interrompu quelques instants pour permettre la venue d’un prêtre qui confessera les mourants, les combattants aussi, et les femmes réfugiées ou prisonnières dans le souterrain ; la naissance de deux bébés, enveloppés dans des langes de fortune, barbouillés de suie et de poudre, au milieu même de cet enfer (et le prêtre les soulève, et les baptise) ; le suprême assaut, la lance d’arrosage accrochée à un camion d’essence, prêt au feu, et cet enfant qui sort de la citadelle, sous les balles, qui s’empare de la lance et la retourne contre les assiégeants, puis tombe mort, la face sur le sol ; les avions amis qui jettent des provisions, des armes, mais les provisions et les armes tombent en dehors de l’enceinte ; le sang, la misère, la maladie, la mort, traduites en images sublimes. Je ne crois pas qu’on ait rien pu inventer de plus saisissant et de plus fort.
Vous me demanderez, ma chère Angèle, quel est le titre de ce film bouleversant, dans quelle salle on peut le voir. Hélas ! Je suis bien forcé de vous avouer qu’il vous faudra pénétrer pour cela dans quelque salle des châteaux de l’âme, comme disent les mystiques espagnols. C’est là seulement, et par la grâce de votre imagination, ou peut-être par quelque don de prophétie, que vous pourrez voir nos Marins de Cronstadt à nous, que nous appellerons, si vous le voulez bien, Les Cadets de Tolède. Car ce film n’existe pas. Tout ce que je vous ai raconté, vous le savez par les journaux, est pourtant vrai. A tant d’héroïsme, tant d’images magnifiques de la grandeur, nous avons tous été suspendus pendant deux mois. Nous connaissons aussi l’attitude de ceux qui nous demandent d’applaudir Les Marins de Cronstadt : devant les cadets de l’Alcazar, rêveuse et pensant vaguement aux embrassements de son sergent recruteur, Madame Clara Malraux prenait des photographies, pendant que M. Lurçat, désolé d’avoir manqué l’ouverture de la chasse, empruntait un fusil à quelque milicien, et « tirait le rebelle », comme d’autres le lièvre, ainsi que nous l’a raconté fièrement Vendredi.
Je pense, ma chère Angèle, que nous courons le risque de ne jamais voir Les Cadets de Tolède à l’écran, même pas aux actualités, même pas par les photographies de Mme Clara Malraux. Quelle belle oeuvre, pourtant, quelle admirable matière que ces sujets dessinés et construits par le destin ! Seulement, avant même de savoir si l’Espagne nationale comprendra la vertu du cinéma, comme sont en train de la comprendre Hitler et Mussolini, il y a autre chose que je voudrais voir réaliser, et qui est peut-être plus simple. Ces Cadets de Tolède imaginaires, chacun de nous a le pouvoir, justement, de les imaginer. Qu’il le fasse. Qu’il n’ait pas honte de le faire et de le dire. Encore aujourd’hui, trop de gens, trop de braves gens, craignent d’indiquer clairement où vont leurs sympathies, ont peur soit d’un ridicule fictif, soit de quelque compromission. Eh bien, je crois, ma chère Angèle, que ces temps doivent finir.
Le bolchevisme russe a compris la vertu des images et des mythes. Pourquoi n’honorerions-nous pas, nous aussi, nos héros et nos saints ? Aux marins de Cronstadt morts sans savoir pourquoi, pour une internationale dont ils ignoraient même le nom, il convient d’opposer des héros plus volontaires et plus conscients. Les cadets de Tolède, certes, appartenaient d’abord à l’Espagne, dont ils sont une incarnation symbolique désormais aussi admirable que celle des héros de la reconquista et du chevalier enterré à Burgos. Mais de si hautes vertus peuvent servir d’exemple à tous, et nous avons le devoir de dire que nous les honorons. Pendant des années, on a appris au peuple français, et à la bourgeoisie française en particulier, qu’il ne fallait pas donner dans les grands sentiments. Je respecte le sens de la pudeur et de la discrétion, pourvu qu’on ne le confonde point avec cette ‘‘mesure » que j’ai en horreur. Mais un peuple a besoin de rapprendre, parfois, les grands sentiments, et il ne le peut que si on lui enseigne qu’il doit honorer, partout où il les rencontre, les grandes images de l’honneur et du mépris du monde.
M. Blum me permettra, ma chère Angèle, de citer la Bible où il est dit que ‘‘sans vision, le peuple périt ». Je crois assez à cette vérité mystérieuse. Dans un temps où ne manquent pas les horreurs, les vilenies et les platitudes, il convient de ne pas avoir honte de nos visions et de nos images : en attendant de les voir vraiment, plaçons celles des cadets de Tolède sur l’écran idéal de notre Panthéon à nous.
Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 26 septembre 1936