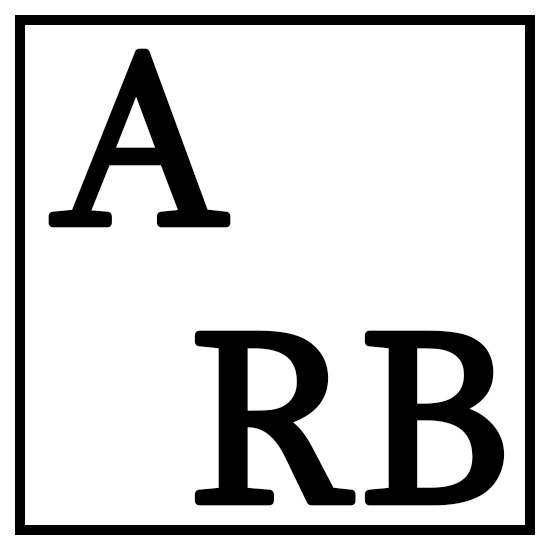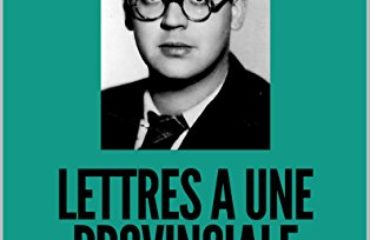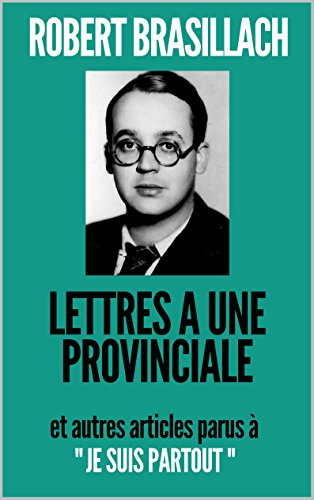
Dans ces temps troublés, la mort de Luigi Pirandello sera-t-elle capable de ramener l’attention sur cet écrivain si savoureux, et l’un des rares qui aient connu, ces dernières années, le paradoxal destin d’être à la fois très illustre et un peu oublié ? Paris, qui avait tant fait pour sa renommée, commençait à l’ignorer. Le pirandellisme semblait seulement, comme le freudisme, une maladie d’après guerre, une de ces virulentes affections en isme, tantôt nommées d’après le nom de leur inventeur, et tantôt, comme le surréalisme, d’après un bacille plus abstrait. Il faut espérer pourtant que l’avenir verra autre chose dans ce subtil magicien qui, tout compte fait, demeure le seul dramaturge européen depuis Ibsen.
Il est très vrai que l’après-guerre fut sa patrie temporelle, depuis qu’on avait vu entrer, par l’ascenseur des Champs Elysées, les six personnages qui nous apportaient un auteur. Pendant quelques années, on se plut à ces jeux de l’intelligence. On se rappela que Charles Dullin avait monté le premier La volupté de l’honneur, on alla un peu partout applaudir les traductions de Benjamin Cré- mieux. Georges et Ludmilla Pitoëff et leur compagnie attachèrent leur nom à la propagande du pirandellisme, et c’est grâce à eux qu’un beau jour de 1926 nous pûmes voir cette comédie magnifique, sommet et parodie à la fois de la doctrine, Comme ci ou comme ça. Ensuite, la courbe de cette gloire s’inclina, et les Pitoëff encore, au moment du prix Nobel de 1934, nous montrèrent la dernière oeuvre du dramaturge sicilien, Ce soir, on improvise, qui est une reprise des thèmes des Six personnages. Peut-être trouverait-on inutile de rappeler ici l’aspect général de ce théâtre, dont on a pu dire qu’il était avant tout un théâtre de la connaissance. Par là convenait-il assez bien à une époque fort intellectualiste, malgré l’apparence, et les intermittences de l’esprit selon Pirandello rejoignaient vite les intermittences du coeur et de la mémoire selon Proust. Longuement, avec une sorte de facilité prodigieuse, l’héritier des improvisateurs italiens (il a écrit cinquante pièces) se plaisait à opposer dans sa moderne Commedia dell’ arte l’image de l’homme réel et les images que s’en forment sa famille, la société. Aussi, je crois bien qu’en un sens ses deux drames les plus caractéristiques restent Henri IV, où un fou, qui s’est pris un jour pour l’empereur d’Allemagne, vit déguisé, entouré d’une cour complaisante, et conserve son déguisement et son existence le jour où il recouvre la raison, parce que changer sa vie n’aurait plus de sens, et La volupté de l’honneur, où une canaille intelligente que l’on force à jouer un rôle d’honnête homme, y prend goût, met tout le monde dans l’embarras par excès de vertu, et réconcilie en lui apparence et vérité.
Ce ne sont pas là des nouveautés, et il faut rire au nez de ceux qui voient en Pirandello un profond auteur philosophique. Il y a dans de telles assertions un excès d’inculture. Je suis toujours étonné, par exemple, que parmi les prédécesseurs du pirandellisme, on ne cite jamais Musset, qui a pourtant écrit avec Lorenzaccio une très admirable Volupté du déshonneur, où il oppose d’une manière poignante, lui aussi, masque et visage. Mais cette opposition, qui n’est point neuve, personne ne l’avait jamais mise au centre d’une oeuvre avec autant de persistance, d’ingéniosité créatrice, de sens dramatique, que Luigi Pirandello.
Ses oeuvres les plus célèbres sont donc justement celles où la vérité est reflétée en miroirs divergents, et surtout les jeux intellectuels des Six personnages, de Comme ci ou comme ça. Non seulement, au centre de l’oeuvre, les héros opposent masque et visage, mais, en outre, on nous explique constamment que nous ne sommes pas devant la vie, mais au théâtre. L’auteur révèle le dessous des cartes, nous avertit que tout n’est qu’illusion, au moment même où nous allions le croire, et lorsque nous sortons de la salle où se sont affrontées ces créatures étranges, nous nous demandons si la réalité du monde visible est beaucoup plus réelle que l’illusion de l’art.
Tout cela, on le sait, mais on n’a peut-être pas assez remarqué que ceux qui ont tenté d’imiter Pirandello se sont vite cassé les reins. Car ils ont oublié que dans les pièces les plus surprenantes de Pirandello, celles où l’illusion semble être maîtresse de la scène, la galerie des glaces reflète un monde assez solide. Du thème central de Six personnages (l’histoire du père), du thème central de Comme ci ou comme ça (l’histoire de l’héroïne), du thème central de Ce soir, on improvise (la jalousie), on pourrait tirer une bonne pièce en trois actes, sur le modèle du Boulevard. Et cette pièce est au moins commencée avant que l’auteur, à un moment, n’intervienne et n’abandonne le jeu. C’est-à-dire qu’il y a toujours, dans un drame pirandellien, une sorte de noix bien dure. C’est seulement ainsi, si l’on y réfléchit, que le pirandellisme peut séduire. Quand M. Jean-Victor Pellerin nous montre M. Ixe et M. Opéku, nous n’y croyons pas. Nous croyons, au contraire, à des personnages qui nous sont présentés comme des êtres vivants, et lorsque, ensuite, on vient nous dire qu’ils n’existent pas, qu’ils sont des chimères, c’est alors que nous sommes troublés. Mais, pour être troublés, il a fallu que nous croyions à eux. Il faut, pour que le virus pirandel- lien opère, qu’il s’attaque à des êtres de chair.
C’est que le Sicilien travaillait presque toujours sur une nouvelle, et il est un nouvelliste incomparable. La nouvelle est le centre résistant de son oeuvre dramatique, sur laquelle il peut broder à souhait. On le voit particulièrement bien si on compare Ce soir, on improvise et l’admirable et sobre récit dont le drame est tiré. Cette nouvelle, Pirandello commençait d’ailleurs à la mettre en scène avec une extraordinaire force scénique. Je sais bien qu’on lui dénie habituellement ce don. Mais que l’on voie La volupté de l’honneur. Je ne dis pas qu’on ne se perde pas un peu dans les subtilités du troisième acte. Mais comme on se passionne pour la figure centrale de l’homme tenté par l’honneur ! Comme on se passionne, dans Tout pour le mieux, pour le héros affaibli qui découvre un jour que toute sa vie a reposé sur un mensonge ! Tout cela est extraordinairement pirandellien, et en même temps extraordinairement dramatique et vivant.
C’est que, contrairement à ce qu’on a toujours cru, Pirandello commençait par ajouter foi à ses héros : sans la foi, sa désillusion ne serait pas possible. C’est cette foi qui apporte, pour finir, à ce théâtre si subtil et si plaisant, un élément qui me semble primordial, malgré le peu d’intérêt qu’on y a porté, et qui demeure un élément humain. On se rappelle le thème de Chacun sa vérité. Des inconnus font l’objet des conversations d’une petite ville. Il y a un mystère en eux. Comment le percer ? L’homme vient expliquer son cas : il vit avec sa belle-mère qui est folle ; sa femme est morte, il s’est remarié, mais la belle-mère croit que la seconde femme est toujours sa fille, et personne n’ose la détromper. Seulement, lorsqu’on interroge la belle-mère, elle donne une autre version : son gendre est fou, il a cru que sa femme était morte et qu’il en avait épousé une autre. Impossible de connaître la vérité, car cette famille étrange vient de Sicile et ses papiers ont été détruits par un tremblement de terre. Et lorsqu’on interroge la jeune femme, qui seule sait la vérité, elle refuse de répondre, car justement elle est la vérité.
On a cru se trouver en présence d’un apologue ingénieux, sorte de résumé du pirandellisme. Mais il faut voir d’abord autre chose : il faut voir que cet homme, cette femme, sa belle-mère s’aiment profondément, et qu’ils sont prêts à tout pour sauvegarder leur bonheur. Voilà l’essentiel : l’oeuvre de Pirandello est une mise en scène des rêves, des pauvres illusions que font les hommes devant la souffrance. Je crois bien que si l’on ne comprend pas que la souffrance est au centre de ces commentaires subtils, on ne comprend pas grand-chose au plus original des dramaturges de ce temps. Les héros de Chacun sa vérité ne sont pas des symboles déguisés. Ils sont des êtres humains soumis à une inquisition terrible, et qui s’en tirent par le déguisement. Ainsi sans doute faisons-nous tous.
C’est pourquoi cette oeuvre, aujourd’hui achevée, m’a toujours apparu comme une oeuvre évidemment fort intelligente, mais aussi comme un témoignage de sensibilité exquise et de profonde civilisation.
Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 19 décembre 1936