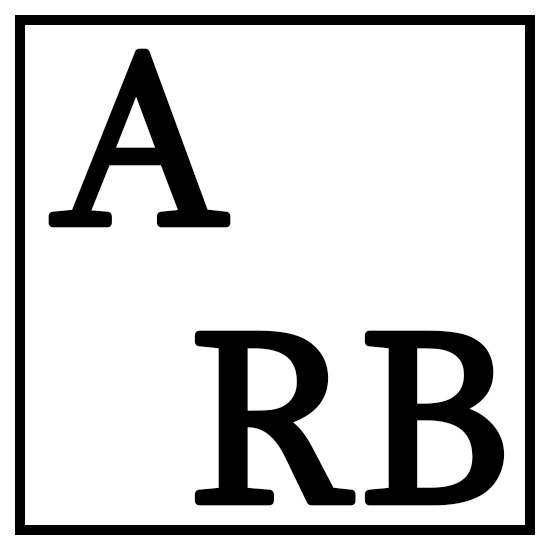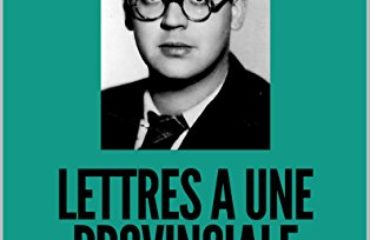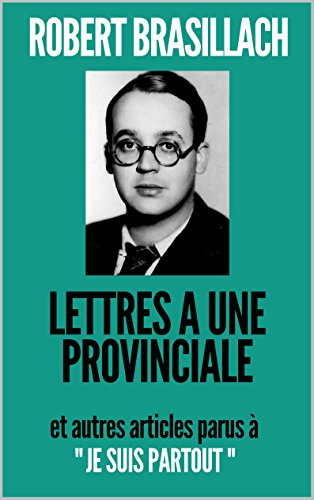
Je me trouvais, il n’y a pas longtemps, ma chère Angèle, dans une maison fréquentée par des patriotes. Vous êtes une belle jacobine, et je suis sûr que vous donnerez à ce mot le sens qui convient : je veux dire que la plupart des personnes présentes étaient des amis, soit de M. Blum, soit de M. Zay, soit encore de M. Thorez. La conversation, vous n’en doutez pas, vint sur la politique et sur les divers événements qui troublent notre planète. Comme les personnes dont il s’agit étaient fort au courant de ce qui se passe, elles savaient que M. Léon Degrelle, après l’interdiction qui lui fut signifiée de parler en France, avait écrit sur notre pays « légal » un article véhément, elles savaient aussi que le général Franco n’était pas tout sourire pour le Front populaire, et que M. Antonesco n’avait aucune admiration pour le pacte franco-soviétique. Comme on évoquait l’une ou l’autre de ces personnalités éminentes, l’un des assistants lâcha le grand mot:
‘‘Il n’aime pas la France. »
Je me permis, ma chère Angèle, d’élever la voix, et, sans vouloir examiner si cette parole ne manquait pas un peu de nuances, de dire à mon interlocuteur :
« Mais, pardon, si vous étiez à la place d’un Roumain ou d’un Espagnol, est-ce que vous aimeriez la France ? »
On me regarda comme on doit regarder le mécréant qui, en plein prêche du curé, exprimerait soudain à voix haute ses doutes sur l’existence de Dieu ou sur l’infaillibilité pontificale. Un océan de réprobation semblait avoir déferlé sur cette maison bourgeoise. Notre hôtesse déjà vérifiait mentalement ses petites cuillers : quand on dit des choses pareilles, n’est-on pas capable de tout? Je n’avais pas emporté les fourchettes à entremets, mais je persistai dans mon opinion.
A vous qui êtes raisonnable, ma chère Angèle, ne peut-on dire la vérité ? Cela a toujours été la rage de la France de vouloir être aimée, comme si on fondait une politique sur l’amour et sur le plaisir. Elle s’imagine de bonne foi être entourée de soeurs latines, de tantes anglo-saxonnes, de lointaines amies slaves et de cousines germaines. Lorsque le petit frère belge prétend qu’il n’est pas si petit que cela, ou que la soeur latine déclare qu’elle veut sortir sans chaperon, le bourgeois français s’indigne comme lorsque sa belle-soeur ne l’a pas salué dans la rue. Il faudrait tout de même abandonner cette politique de querelles de famille qui nous a assez souvent rendus ridicules.
Mais il y a mieux encore, ma chère Angèle. Il est entendu que nous devons être aimés. Un Tchécoslovaque disait un jour à un de mes amis: « J’aime tant la France ! C’est le pays de la Révolution et de la Franc-Maçonnerie. » Mon camarade n’osa pas le détromper, et, pourtant, qui ne verrait avec évidence l’illogisme de ceux qui se plaignent de n’être pas aimés, même par ceux qui ne goûtent ni la Révolution, ni la Franc Maçonnerie ? Au temps où de pareilles idées étaient vivantes, qu’on les approuve ou qu’on les blâme, la France pouvait réclamer d’être suivie. Aujourd’hui (je parle de la France officielle), notre pays n’est plus à la mode, que nous le voulions ou non. On porte d’autres chapeaux que le bonnet phrygien, d’autres chemises que les tabliers maçonniques ; on se salue autrement qu’en se grattant le creux de la main. Au nom de quoi, ma chère Angèle, réclamons-nous l’amour de ceux qui ont changé de règle ?
J’aime mon pays, ma chère Angèle, parce que je sais ce qu’il est en réalité, et que son passé magnifique peut me répondre de son avenir. Mais j’avoue que je suis tout indulgence pour ceux qui le jugent sur son accoutrement moderne. Il est malaisé de s’informer à l’étranger, malaisé de distinguer entre ce qui est et ce qui apparaît. Contrairement à ce que disent les néo-patriotes, les déclarations récentes de quelques-uns des chefs qui nous entourent nous permettent de supposer qu’ils font les distinctions nécessaires. J’avoue que je m’en émerveille, que je suis ébloui de leur patience, de leur indulgence d’hommes d’Etat. Nos chauvins de la prochaine dernière en auraient-ils autant ? On peut en douter.
Seulement, bon gré mai gré, nous semblons ne faire qu’un avec une certaine meute qui prétend s’appeler France. Il faut dire à Degrelle, sans doute, qu’un président du Conseil d’origine juive allemande (si ce n’est balkanique) et un ministre de l’Intérieur douteux, quelles que soient les opinions que l’on ait, ne sont pas, au sens précis et humble du terme, ne sont pas citoyens français.
C’est en toute sincérité que je le dis, ma chère Angèle : si, pendant quelques instants, je me suppose Belge, ou Italien, ou Espagnol, ou Patagon, je n’aime pas l’Etat français, parce qu’il ne représente rien aujourd’hui dans le monde que les idées les plus détestables, le conservatisme social le plus périmé voué au chambardement anarchique, la peur et l’amour du désordre, la politique de larmoiement alternant avec la politique de bravade, et l’hypocrisie par dessus le marché. Pour aimer cet Etat-là, il n’y a personne, car ceux-là mêmes qui s’en servent le méprisent profondément. Quant aux autres, j’admire en vérité ceux qui savent voir au-delà des apparences et qui, par-dessus la tête des maîtres qui I’asservissent, essayent de parler à nos véritables compatriotes. Je ne suis pas sûr, à leur place, d’être capable d’en faire autant.
Il faut voir les choses comme elles sont, et ne pas se leurrer. Il est ridicule et criminel de s’étonner qu’on prononce à l’étranger des paroles dures contre la France. Notre devoir n’est pas de nous plaindre, mais d’empêcher que de telles paroles soient légitimées. Nos va-t-en-guerre et nos braves à trois plumes, avec les rires dans les cimetières de M. Malraux, et les jolis mouvements de menton de M. Chamson, et le tir-aux-Cadets de M. Lurçat, veulent à toute force confondre notre cause avec la leur, et donnent des leçons de patriotisme. Elles sont fabriquées à Moscou : nous n’avons pas la monnaie qu’il faut pour régler ces marchandises-là.
Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 17 octobre 1936