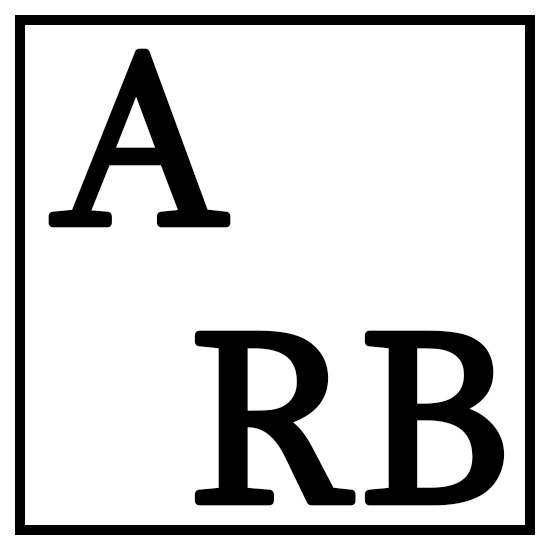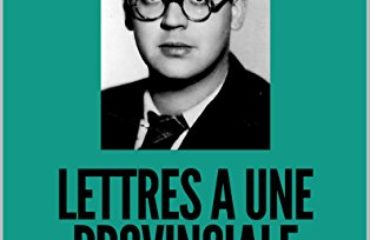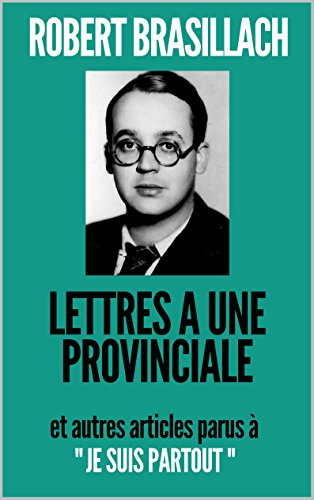
Au temps où M. Gide, ma chère Angèle, vous adressait des billets doux et ne levait pas encore le poing dans les cortèges antifascistes, vous vous rappelez peut-être qu’il avait porté sur l’art « populaire » un jugement à la fois savoureux et définitif. Il avait déclaré que l’expression : « Le poireau est l’asperge du pauvre » était insultante à la fois pour le poireau, pour l’asperge et pour le pauvre. J’avoue que j’ai beaucoup pensé au poireau de M. Gide, pendant ces jours où les intellectuels, comme l’on sait, vont au peuple.
Quand je pense à ces représentations du Quatorze Juillet de M. Romain Rolland, avec le ramassis des plus mauvais acteurs de la Comédie-Française (vous n’avez jamais entendu, en tournée, les glapissements de M. Vidalin ?) ; quand je pense à ces articles à la fois « enthousiastes » et « instructifs » que publient Vendredi ou l’Humanité, et quand je me remémore, hélas ! les rassemblements populaires de notre fête nationale, ce malheureux poireau me semble être l’emblème de la Maison de la Culture. Car il est bien certain que tout ce que prévoient nos intellectuels pour distraire et pour exalter « les masses » (je n’aime guère cette expression méprisante), c’est un art au rabais, c’est de l’histoire au rabais, c’est la beauté en solde, et l’Uniprix de l’enthousiasme.
Je prévois, sans doute, ma chère Angèle, que je vais vous attrister. Mais ce n’est pas la première fois que l’on découvrirait chez ces démocrates un mépris aussi profond, aussi total, pour ce qu’ils nomment si gentiment « les masses ». Ils prétendent offrir au peuple la beauté, et ils ne lui offrent que des parades grotesques, qui d’ailleurs ne suscitent aucune joie. Ce n’est pas la peine d’avoir blagué la Comédie-Française avec tant d’ardeur pour aller faire appel à quelques sociétaires, et à l’épouvantable M. Vidalin, lorsqu’on songe à tirer de son cercueil M. Romain Rolland. Tout cela, dont nos esthètes ne voudraient évidemment pas pour eux-mêmes, ils pensent que c’est assez bon pour les électeurs du Front populaire.
Il y a pourtant, ma chère Angèle, une grande banalité à laquelle je ne puis m’empêcher de songer : c’est que les belles oeuvres du passé ont été celles où les masses, comme ils disent, et l’élite, trouvaient des plaisirs non point égaux, mais semblablement forts. Je pense, devant M. Romain Rolland, à Sophocle et à Shakespeare. Il ne s’agissait pas là de se mettre à la portée d’un vaste public par l’abaissement. A toute oeuvre grande chacun peut trouver sa nourriture, pourvu que certaines lois soient respectées. Mais la vaste entreprise d’abêtissement qu’on appelle le mouvement intellectuel n’a de souci que de propagande. Les Russes nous ont appris à quelle bassesse, à quelle grossièreté peut descendre cette propagande. Encore ont-ils pour eux, peuple béni, de grands metteurs en scène, le goût de l’image et de la couleur. Nous autres, nous engageons la Comédie-Française au service des professeurs.
Et je ne voudrais pas vous parler encore du quatorze juillet. Mais enfin, chère Angèle, si ce lent et lourd piétinement avait eu quelque beauté, je vous assure que je ne suis pas insensible à la séduction parfois insolente des grandes foules. Tout ce que nous avons pu voir, vous le savez, c’est une foire endimanchée. Où était l’enthousiasme révolutionnaire ? Et même les applaudissements, les chants, les cris? J’ai bien entendu chanter l’Internationale, mais par cinquante voix, et jamais beaucoup plus. Imaginez-vous le fracas énorme, et la beauté d’une foule chantant tout entière ? Il est assez aisé de se rendre compte que si celle de la place de la Nation l’avait fait, on s’en serait aperçu ! Je n’ai vu que des curieux, des manifestants harassés, je n’ai pas entendu s’exprimer la foi populaire. Que voulez-vous, ma chère Angèle : on n’a pas voulu donner au peuple ses fêtes, les fêtes qu’il a à Moscou ou à Berlin. On s’est dit: « Il se contentera de marcher, en tas, à la va-comme-je-te-pousse. Avec quelques drapeaux, et les barbes irrésistibles de la délégation des Droits de l’Homme (les barbus avec nous !), le tour sera joué. » Et le tour n’a pas été joué, car tout cela était vraiment trop morne et trop laid.
Je crois que la France aura fort à faire avant de donner à ses citoyens les grandes fêtes qu’on lui promet. Tout ce qui est laïque, dans notre pays, a toujours été profondément ridicule, et les seules manifestations « de masse » réussies n’ont jamais été que celles de l’armée et celles de l’Eglise. Un docteur du Front populaire, Alain, a écrit souvent de fort belles pages, ma chère Angèle, sur l’idée de cérémonie. On devrait peut-être quêter auprès de ce grand homme quelques conseils. Le malheur est que je me demande si on a seulement envie de ces conseils. « Aller au peuple », pour ces messieurs, cela veut dire ôter sa cravate et affecter un débraillé intellectuel, physique et moral. A partir du moment où l’on croit qu’il y a un art prolétarien, tout est perdu. On cesse simplement d’écrire des poèmes surréalistes pour rimer quelque ode à la police ou composer quelque feuilleton.
Quant aux masses naïves, elles n’ont qu’à se taire et à adorer. Adorer les cohues processionnelles, les actrices de la Comédie, les pièces poussiéreuses, les gâteux officiels, les poètes imbéciles, les pamphlétaires payés par les banquiers, les marquises et le ministère de l’Intérieur. Aux Romains on donnait au moins du pain et des jeux. Où sont nos jeux, en échange de la liberté ? Le poireau est l’asperge du pauvre, et ceux qui nous le vendent sont bien décidés à nous en faire manger à chaque repas, et à gagner beaucoup d’argent et d’honneurs dans la production intensive de ce patriotique légume de remplacement.
Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 25 juillet 1936