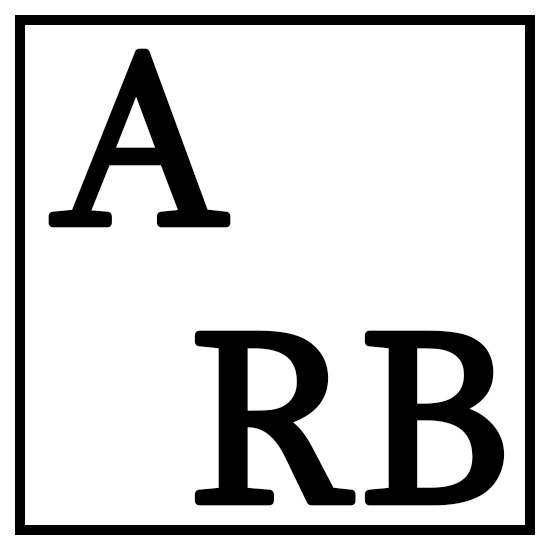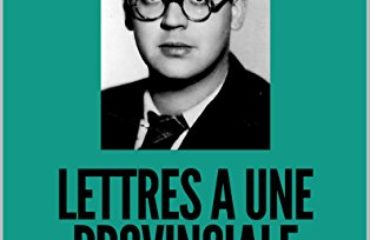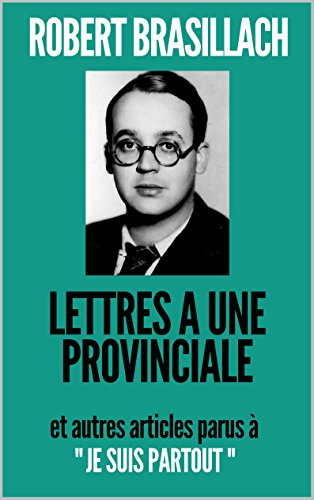
En un temps où tout n’est pas rose, ma chère Angèle, il ne faut laisser échapper aucune occasion de rire. Et ces occasions sont assez nombreuses, à mon avis, pourvu qu’on se donne la peine de penser quelquefois au comportement de nos bons amis les intellectuels antifascistes. Il faut dire que la situation n’était pas toujours drôle pour eux: les uns avaient du talent, mais on les ignorait, les autres n’en avaient pas, et on les ignorait aussi, ou bien on ne les connaissait que trop. Par bonheur, ce gouvernement de Front populaire que l’Europe et la lune nous envient a pris le pouvoir. Aussitôt, une grande ligue a été formée, celle de ces intellectuels, justement, dont personne ne s’occupait, et qui ont commencé de relever la tête. Et nous avons assisté à de bien beaux spectacles.
Tout d’abord, l’union sacrée a été décrétée : Le Canard Enchaîné, qui n’aimait point les artistes de la Comédie Française, se mit à admirer Mlle Marie Bell depuis qu’on avait pu fouir dans le Quatorze Juillet de M. Romain Rolland. M. Maurice Rostand, qui faisait depuis des millénaires les frais de plaisanteries un peu anciennes, devint aussitôt une étoile, un poète sincère, bref, un auteur pour le peuple. M. Gide tomba dans les bras de M. Romain Rolland, dont il avait dit jadis pis que pendre, avec cette ironie supérieure qui faisait son charme. Il renia même les méchancetés intimes dont il avait couvert M. Blum. Bref, de Julien Benda au Merle Blanc, le Front populaire intellectuel fut constitué pour barrer la route au fascisme et faire le trust des décorations.
J’avoue, ma chère Angèle, que j’ai toujours trouvé assez singulière cette prétention qu’ont les intellectuels, depuis le romantisme, de vouloir nous régenter. Au nom de quoi un honnête romancier serait-il meilleur politique que le bistro du coin ? Il se peut que cela soit, mais il se peut aussi que cela ne soit point. Peu importe à ces messieurs : ils signent à tour de bras leurs mandements, leurs manifestes et leurs bulles. Et voici qu’ils prétendent nous donner des conseils que je trouve, pour ma part, assez étranges.
S’est-on assez moqué du joli mouvement de menton attribué à Barrès, un jour où il voulait s’engager ! Nous a-t-on assez parlé du rire de Poincaré dans les cimetières ! Mais qu’on lise Le Populaire : un sieur Hermann, monté à bord d’un avion de bombardement au-dessus de Majorque, y décrit en esthète le claquement des mitrailleuses dans l’air bleu du matin et la guerre fraîche et joyeuse. A quand un hymne à « Rosalie » ? Qu’on lise M. Chamson dans Vendredi, M. Pierre Scize dans Le Merle Blanc : ils battent du tambour avec allégresse, ils s’écrient : ‘‘Armons-nous, et marchez ! », ils préparent la grande parade de la mort: ‘‘Ce n’est que dix sous pour les militaires, et Mme Andrée Viollis versera la goutte ! »
Ah ! que j’aime, ma chère Angèle, ce débordement d’enthousiasme ! Peut-être ne connaissez-vous pas M. Pierre Scize ! Les Lyonnais savent qu’un quai de la Saône porte ce nom. Mais c’est aussi celui d’un journaliste que les organes de gauche, jadis, repoussèrent avec horreur parce qu’il venait d’être décoré. Il a écrit une petite pièce gentille, il compose des articles que l’on prétend sévères et où sont soigneusement respectés tous les conformismes à la mode d’avant-hier. Mais, surtout, M. Pierre Scize est pacifiste. Il a écrit, proclamé cent fois, qu’il ne marcherait plus jamais pour aucune cause. Toutefois, il n’a pas tardé à comprendre qu’une telle attitude était singulièrement vieux jeu et qu’on le regarderait de travers dans les salons. La révolution espagnole lui fut une excellente occasion de sortir de l’ombre. Il commença par nous exposer ses troubles de conscience : n’avait-il pas jadis blâmé M. Romain Rolland d’avoir abandonné le pacifisme intégral ? Eh bien, il s’en confessait aujourd’hui, M. Romain Rolland avait raison : si Moscou est attaqué ou menacé, il faut nous battre pour Moscou. M. Romain Rolland lui écrivit une lettre émouvante, et M, Pierre Scize, ivre de joie, écrivit enfin son plus bel article.
« Ce qui me révolte, moi, imprima-t-il, c’est de ne pas apprendre qu’aux premières heures du soulèvement monarchiste, la France du Front populaire n’a pas été tout de suite, coeur à coeur, bourse à bourse, armes, munitions, volontaires, aux côtés de nos frères de Catalogne et de Castille. C’est de ne pas apprendre qu’en hâte furent dressés aux carrefours les tréteaux de l’enrôlement volontaire. »
Ne cherchez pas, ma chère Angèle, le nom de M. Pierre Scize sur la liste des morts du Guadarrama. Le mot de tréteaux doit être pour vous une illumination : il ne réclame qu’une place éminente parmi les clowns de notre Révolution verbale. Qu’on a du goût à voir s’entre-dévorer les Augustes du Front populaire ! Assez longtemps, grave et vêtu de noir, M. Gide a joué le rôle de M. Loyal, assez longtemps, M. Guéhenno a respiré avec ivresse l’odeur du crottin, et M. Chamson a battu pour le compte des marquises la poussière des tapis. A force de contorsions, M. Jean Cassou, qui n’était pas content de son étoile de papier, a réussi à avoir sa petite place, son voltige désormais en pleine lumière, à travers les cerceaux disposés par M. Léo Lagrange.
Mais une nouvelle équipe montre les dents, mais de nouveaux clowns aspirent à entrer en piste. Voici que s’agitent les hommes du théâtre, les hommes du cinéma : n’ayez crainte, ce ne sont que des hommes du cirque. Par un coup de maître, M. Pierre Scize, hier inconnu, voudrait bien entrer dans la gloire. Il est prêt à tout pour cela, et même à bâtir ces tréteaux d’enrôlement où personne, pourtant, ne l’empêche de s’inscrire le premier. André Malraux peut rapporter d’Orient de drôles de statues ou s’envoler à bord des avions de Pierre Cot. Pierre Scize fera mieux, il fera le sergent recruteur. Quelle nostalgie du joli mouvement de menton ont ces adjudants en disponibilité ! Aussi regardez la parade : on n’en imagine pas de mieux achalandée. Ils sont prêts à tout, ces intellectuels, pour attirer l’attention, au moment où tout le monde se moque d’eux. Un Roi-Soleil peint sur le derrière, André Chamson joue aux grâces avec Jean Zay, un drapeau planté entre les fesses. Jean Cassou marche sur les mains, Guéhenno brandit le violon sur lequel, le 2 août, il jouait la Marseillaise dans une thurne de l’Ecole Normale (il pourra resservir). Et Pierre Scize fait le grand écart.
Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 22 août 1936