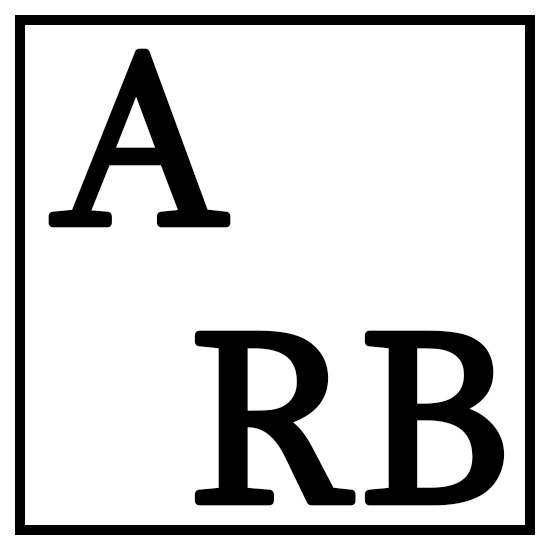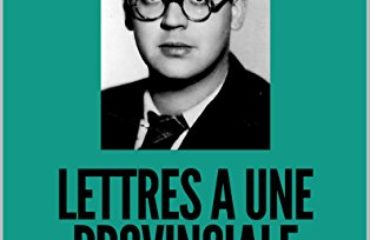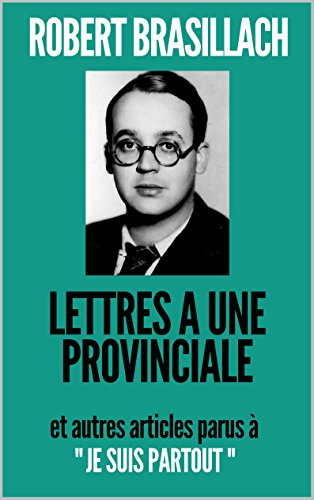
Vous me demandez, ma chère Angèle, s’il convient d’emmener vos enfants, aux prochaines fêtes, voir quelqu’une de ces représentations classiques dont la province dit grand bien, et vous désirez en même temps savoir si Paris est véritablement conquis par le nouveau führer du Théâtre-Français, M. Edouard Bourdet. Je dois vous avouer que Paris n’est pas encore soumis, pour la bonne raison que M. Bourdet n’en est encore qu’aux songes et aux promesses, et on ne peut raisonnablement le lui reprocher. Seuls quelques extrémistes pourraient regretter qu’il ne se soit pas encore livré sur le personnel de ce théâtre à quelque « 30 juin » symbolique, et que, dès sa prise de pouvoir, il n’ait pas tout de suite massacré un bon nombre de sociétaires. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup, d’ailleurs, pour m’inscrire parmi ces extrémistes, et je vous confierai à l’oreille que la haine de la Comédie Française est le seul sentiment durable de ma vie.
Mais ce n’est pas encore de la Comédie qu’il est question, c’est de son chef, c’est du pacifique chancelier qui, si l’on en croit la légende, arrive chaque jour rue de Richelieu à bicyclette, afin de faire un peu de sport. J’ignore si ce détail est exact : j’aimerais le savoir, afin de décider si véritablement les cyclistes gouvernent la France, et si nous devons adopter la chambre à air comme armes parlantes. Les méchantes langues, et je n’en suis pas, trouveraient peut-être là l’occasion de prétendre que M. Bourdet est décidé à avancer prudemment et à n’admettre les réformes nécessaires qu’avec une sage lenteur.
Pour ma part, ma chère Angèle, j’ai beaucoup trop ri à une ou deux pièces de M. Bourdet pour lui en vouloir de sa lenteur et de sa bicyclette. Mais je pense justement à une ou deux pièces, et non pas tout à fait à l’ensemble d’une oeuvre déjà abondante. Et je me demande si dans la surprenante mesure qui a installé l’auteur de tant de vaudevilles agréables à la tête de la Comédie-Française, il ne faut pas voir une des idées les plus cocasses, et peut-être les plus sadiques, qui soient dues à l’esprit démoniaque de M. Zay.
Je n’ai point d’hostilité contre M. Edouard Bourdet. Pourtant, il a commis, dans son existence adroite, une très lourde gaffe : pendant deux ou trois ans, il a été critique dramatique. Pendant deux ou trois ans, chaque semaine, il nous a prouvé en conséquence qu’il n’entendait rien à l’art dramatique. Incompréhensif et charmant, il a buté contre tous les spectacles neufs, et, hélas ! il n’a pas bu l’obstacle. Ce qui le ravissait, on le devinait vite, c’étaient les oeuvres à la manière des siennes, l’adultère mondain dans le genre grave, l’adultère mondain dans le genre gai. L’an passé, certain rapport Bacqué mit en fureur le monde de la scène : ce hardi sociétaire, dont la flèche est au flanc du théâtre abattu, ne réclamait-il pas une sérieuse révision du répertoire ? Ne pouvait-on pas déduire de ses propos que la Comédie n’était pas faite pour accueillir le vieux M. Edmond Sée, prince de la censure cinématographique, le ridicule Saint-Georges de Bouhélier et, parmi les morts, d’Augier à Dumas fils et à Hervieu, les plus poussiéreux des drames et les moins drôles des comédies ? Il fallait agir d’urgence : déjà M. Bernstein se croyait visé par le rapport Bacqué et tempêtait. Ce bon M. Fabre, habitué à mille tourmentes, baissait la tête. M. Jean Zay, quand le Front populaire vint au pouvoir, eut une idée de génie : il fit appel à M. Bourdet.
Ce n’est pas lui, en effet, qui débarrassera le Théâtre Français des pièces du répertoire moderne, puisqu’il travaille « dans le même genre ». On a trouvé en lui le meilleur protecteur de M. Lavedan, puisqu’il est le fils spirituel de M. Lavedan. Ce n’est pas parce qu’il a déguisé en inverti le marquis de Priola que nous ne reconnaîtrons pas la personnalité véritable du duc d’Anche de La Fleur des Pois. De temps en temps, d’ailleurs, il songe aussi à Emile Augier, et il écrit Les Temps difficiles. Il est le meilleur défenseur du théâtre bourgeois, puisqu’il est aujourd’hui le représentant de ce théâtre bourgeois.
Je dois dire, ma chère Angèle, qu’il est habile homme, et que le premier acte de Vient de paraître, que Le Sexe faible tout entier sont des oeuvres d’une grande gaieté. Mais je pense aussi, et cela n’est pas contradictoire, que peu d’hommes ont fait plus de mal au théâtre que M. Bourdet. Car il a perpétué cette forme indéfendable de comédie qui fleurissait bien avant la guerre, et qui, sans lui, aurait peut-être disparu. Il a surtout, avec une constance qui inspire l’admiration et l’effroi, calqué le langage contemporain avec une telle fidélité, qu’aujourd’hui il en arrive à l’argot, l’argot mondain et conventionnel de Fric-Frac.
Lorsqu’on s’intéresse au théâtre, on ne peut qu’en être ému et choqué. J’ai eu un jour l’occasion de voir M. Bourdet, qui est un homme fort courtois, et je lui ai demandé, ce qui me semblait banal, si cette fidélité au langage contemporain ne risquait pas d’accentuer le vieillissement des pièces, et si dans vingt ans on comprendrait une oeuvre écrite dans le dialecte de 1935. Il parut fort étonné, comme s’il n’avait jamais réfléchi à ces questions, et me répondit : « Mais qui de nous écrit pour dans vingt ans? »
Un tel mot, vous en conviendrez, ma chère Angèle, est significatif. C’est pour cela sans doute que les personnages de Margot s’expriment comme les habitués de Montmartre. C’est pour cela aussi que je ne crains pas grand-chose pour le Théâtre-Français. Pour un esprit habitué, dans son oeuvre, à tant de mollesse, la convention apparaît vite comme le suprême refuge de ce qui est noble. Par la force des choses, on donnera bien à M. Jouvet ou à M. Copeau, de temps à autre, une oeuvre ancienne à monter. Mais la vieille garde sera toujours là, protégée par M. Bourdet ; mais M. Albert Lambert reviendra rugir, et Mme Marie Bell et M. Vidalin, et Colonna Romano avec Alexandre. M. Bourdet n’osera jamais, ne voudra jamais rendre vivantes ces allégories, parce que la vie, pour lui, c’est « le milieu » ou « le palace », et que la beauté, c’est justement la convention. Il est pareil à ces braves gens qui, volontiers grossiers dans l’existence courante, admirent le Salon des Artistes Français, les pères nobles de tournée et les oeuvres bien-pensantes. Modestement, il s’excepte du jeu, et fait son métier, son métier qui est de peu d’années, il l’avoue. Pour le reste, il a le respect des momies, soyez-en sûre. Le Théâtre Français n’a encore monté comme nouveautés qu’une pièce de Dumas fils et une pièce de M. Fabre, exhumée de derrière les fagots du Théâtre Libre. Ce n’est pas aujourd’hui que la scène de la rue Richelieu retrouvera sa raison d’être et sa mission.
Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 14 novembre 1936