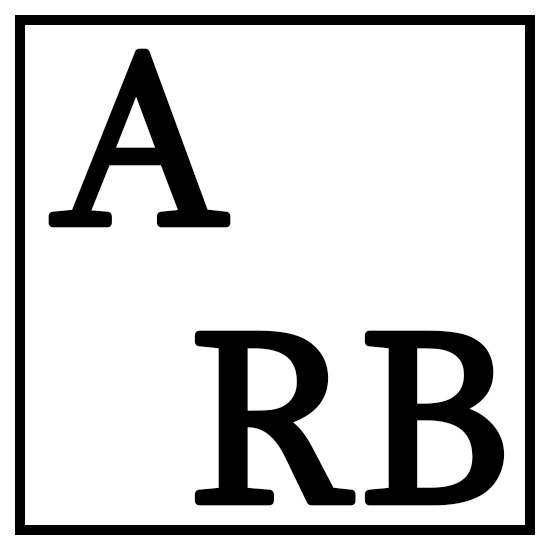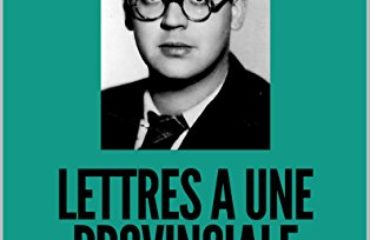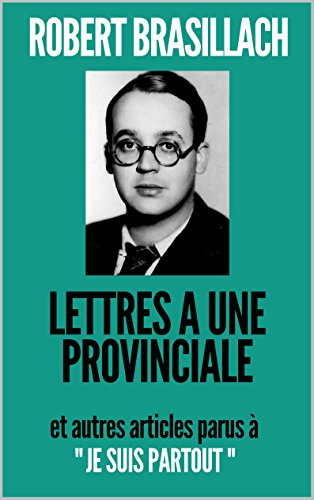
Dans la salle où je vous écris, ma chère Angèle, se trouve un drapeau français que je considère avec amitié. Il est fait de morceaux assez grossièrement assemblés : le bleu n’en est pas très franc, et la hampe est un roseau. Ce drapeau a servi à traverser la frontière à un Espagnol suivi de près par des miliciens antifascistes. Tous ces jours-ci, je vois passer des autos où des drapeaux français énormes sont peints grossièrement à l’arrière, ou qui portent alternativement les initiales de la Fédération anarchiste, et, plus souvent encore, les mots Consulado francés, Dans la voiture parée de ces mots protecteurs, l’autre jour, il y avait des Autrichiens, des Espagnols, des Italiens, qui ne se connaissaient pas entre eux et qui avaient réussi, sous ce drapeau, à passer la frontière. Tout cela, lorsqu’on le voit de près, est assez émouvant.
C’est d’un village de Cerdagne que j’écris cette lettre, et vous savez que, depuis que le traité des Pyrénées a partagé la Cerdagne en deux, Français et Espagnols ne cessent pas de se regarder avec amitié. On considère ici de plus près qu’ailleurs les événements d’Espagne, parce que tout le monde connaît des Espagnols. Si vous avez lu l’admirable article de M. François Mauriac de l’autre jour, l’un des plus beaux qu’il ait écrits, vous comprendrez, ma chère Angèle, avec quelle fureur tous les Français, mais ceux du Midi, les Pyrénéens plus encore, ont appris que le gouvernement de M. Blum pouvait aider (a aidé, si l’on en croit M. Zyromski) des Espagnols à s’entre-tuer. On me dit qu’à Céret, on me dit qu’au Boulou, qui sont de charmants villages pas très loin d’ici, on a vu passer des avions français qui se dirigeaient vers la frontière.
Je franchirai cette douce pente qui sépare le Conflent de la Cer- dagne, et je pourrai apercevoir la petite ville de Puigcerda, où je suis allé bien souvent, et où, pour les fêtes de la Vierge, on fait à coups de confetti de si belles processions. Que sera le 15 août à Puigcerda ? De Font-Romeu, on pouvait en voir brûler les maisons, et, tout à l’heure, nous venons d’apprendre la mort du maire et d’un notaire. Ce fut une belle mort, à la manière des victimes de Scarface. Les révolutionnaires du pays, dans cet air pur, sous ce soleil rayonnant, n’ont peut-être pas assez de courage pour accomplir seuls leur triste besogne. Alors, Barcelone envoie en auto, en camion, des équipes de tueurs. En quelques heures, on peut aisément clouer au mur le maire et les notables, et le curé par-dessus le marché, déterrer les religieuses mortes et les exposer sur les marches des églises, fusiller les petits garçons à béret rouge, puisque le béret rouge, là-bas, n’est pas l’insigne des Faucons de M. Monnet, mais celui des carlistes. Puis les équipes de tueurs repartent sur leur camion, à toute allure, sur les routes défoncées, et peut-être chantent-ils les admirables vieux chants de révolte des Catalans ou encore leur Internationale :
Es la lluta darrera,
Arropen nos, germans, L’internationala sigue La patria dels humans…
Si près de la frontière, sur ces routes que gardent les gendarmes armés, où tout à l’heure est venu le général commandant la région, il n’est pas malaisé d’imaginer ces scènes. Il suffit d’écouter parler ces Espagnols qui viennent de descendre d’une voiture amicale, de les voir s’assembler pour lire les journaux français, se demander s’il est possible de rentrer dans leur pays par la côte basque. Et toujours, toujours, ces automobiles bariolées qui passent, puisque, pour peu de temps sans doute, les trois couleurs françaises sont encore une protection.
Les gens de ce pays, dans la montagne tout au moins, ont beaucoup à faire dans leur vie et ne s’occupent pas beaucoup de politique. Hier, j’étais dans un village assez isolé, qui doit bien compter cinq cents habitants (encore est-ce une capitale, celle de l’ancien comté de Capcir), et où l’hiver est très rude.
« Nous avons des communistes ici, savez-vous, me dit-on avec un peu de fierté. Ils sont sept. Et encore il y en a au moins six qui ne savent pas très bien ce que ce mot veut dire. »
Heureux pays qui ne compte encore que sept communistes, et qui peut-être bat le record de la région ! Mais déjà on se demande si cela durera encore longtemps, et si la politique ne vient pas chercher ceux qui ne désiraient pas s’occuper d’elle. Déjà, le réveil national s’est accentué d’une manière extrêmement nette en Alsace, où l’on a brûlé à Haguenau, fief de l’autonomisme, le mannequin du Heimatbund. Déjà, la querelle des sanctions a fait réfléchir les gens des Alpes et de Provence, qu’ils soient rouges ou blancs, et les a violemment séparés du gouvernement, comme l’on sait. Les événements d’Espagne, qui mettent en danger, par un paradoxe prodigieux, la plus sûre de nos marches, vont-ils avoir le même résultat? Ce n’est pas impossible. Car il est malaisé de ne pas songer au jour où, sous un pavillon anglais, par exemple, les Français qui ont une auto seront obligés de transporter leurs amis qui n’en ont pas.
Par la grâce d’un gouvernement de pleutres et de bandits, les cyniques, les marchands d’armes, les sadiques comme ce petit Pierre Cot (il suffit de regarder son portrait pour deviner chez lui on ne sait quel érotisme du sang et de la mort), font la loi à ces pauvres gueules de pions chahutés que montrent Blum et Salengro.
Le jour viendra, le jour n’est sans doute pas loin où nous confectionnerons avec des tabliers de cuisine et des robes de petite fille quelque bannière étoilée, quelque étendard de l’Union Jack. Où nous apprendrons que Paris ou Lyon, ou Marseille ont envoyé dans les petites villes leurs camions de tueurs. Où les évêques rouges seront pendus dans leurs chiffons de pourpre, et les curés démocrates éventrés avec leurs enfants de choeur, au pied des croix renversées et des ciboires souillés d’excréments.
Il faut nous hâter, ma chère Angèle, de trouver un pays secou- rable, un drapeau qu’on n’ose pas trop offenser. Puisque la France n’a pas de gouvernement, hâtons-nous de réclamer au moins les avantages du protectorat.
Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 8 août 1936