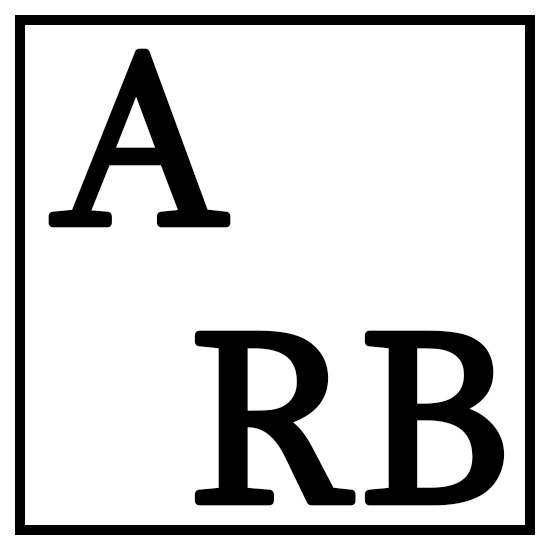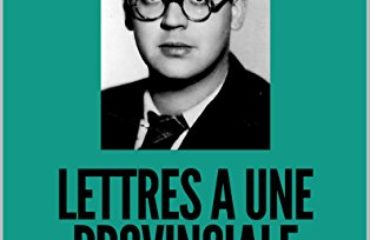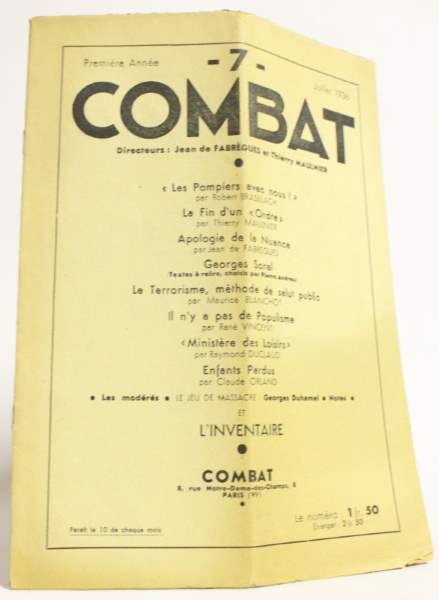
Elégie en l’honneur de genres disparus
Si l’on regarde un rayon de bibliothèque, même peu garni, où sont des œuvres classiques, il est impossible de ne pas faire une réflexion. Voici, côte à côte, et en désordre, Rabelais, « Don Quichotte », le théâtre de Racine, celui de Corneille, de Molière, voici Montaigne, voici les Contes de Voltaire, un peu plus loin, voici Diderot et voici Balzac, voici des poèmes. Sans parler de Pascal et de Bossuet. Dans l’ensemble, n’est-ce pas là une vue assez ample sur les lettres française, et même sur les lettres tout court. Aussi me permettra-t-on d’être un peu effrayé si l’on songe que tous ces grands écrivains, il n’en est pas beaucoup qui trouveraient aujourd’hui la gloire, ou peut-être plus simplement un éditeur. Avec toutes les différences de temps que l’on voudra, je ne vois guère que Balzac et Diderot pour être, en apparence, des hommes d’aujourd’hui. C’est qu’ils sont romanciers. A la rigueur, j’admets Pascal, j’admets Bossuet (on comprend ce que je veux dire, et il est trop sûr que nous n’avons ni Pascal ni Bossuet). Mais où sont nos contes satiriques ? Où sont nos épopées bouffonnes ? Où sont nos tragédies ? Où sont nos libres « essais » ? On peut même dire, en beaucoup de cas, où sont nos poètes ? Et si le théâtre comique est un genre qui fleurit encore, comme il est loin de la stylisation de Molière !
Les jeunes gens qui débutaient dans les lettres il y a plusieurs siècles, ou même simplement plusieurs décades, avaient le choix entre des voies diverses, toutes richement illustrées. Aujourd’hui, ils sont critiques (et, de plus en plus, critiques politiques), ou ils sont romanciers. Je ne médis pas de ces deux genres, on me rirait au nez. Indépendamment des malfaçons personnelles, ce sont d’ailleurs de très grands genres. Je songe pourtant au mot de M. Jacques Bainville, un peu paradoxal, mais si juste, que la grande erreur du XIXe siècle est d’avoir réduit toute œuvre d’art au roman, et peut-être d’avoir vu dans le roman une œuvre d’art. Le roman a si peu de règles qu’il comporte mille aspects différents et qu’on appelle roman toute œuvre contée où apparaissent des personnages et un décor. Mais je me souviens aussi de ces époques que les manuels de littérature oublient si dédaigneusement (et si injustement d’ailleurs), parce qu’elles furent réduites à un seul genre littéraire : essais et vies romancées. Croit-on que l’époque mérovingienne, dans mille ans, paraîtra si différente de la nôtre ?
Les lettres, cependant, devraient séduire nos jeunes gens par d’autres attraits. Seuls les poètes subsistent. Ils chantent abusivement, souvent maladroitement. Ils ne font pas beaucoup de bruit, et ce n’est pas tout à fait leur faute. Mais de temps en temps, dans le flot des plaquettes imprimées à leurs frais, on peut trouver quelque originalité vraie, sous des vêtements d’emprunt. Je ne parle pas d’un Patrice de La Tour du Pin, qui sera peut-être un jour (ce jeune homme de vingt-quatre ans), le grand poète de sa génération et de son temps. Mais d’autres réussissent à se faire entendre : J’ai reçu naguère de Bordeaux, des vers de Jean Cayrol (Ce n’est pas la mer), des vers de Jacques Dalléas (L’autre côté de la terre) qui, en d’autres temps auraient peut-être paru des découvertes. Mais le temps n’est plus aux poètes.
Il est moins encore aux rénovateurs de formes anciennes et nobles. Et c’est peut-être à cela que l’on devrait songer, à cela que devrait servir, dans la mesure de ses moyens, tout groupe de jeunes.
On ne demande pas à un théâtre régulier de monter des tragédies (en vers ou en prose), on ne demande pas à un éditeur de publier une épopée, un recueil de chants lyriques, ou une bouffonnerie stylisée en deux mille pages, comme « Don Quichotte » et « Gargantua ». Mais on aimerait voir, dans la mesure de leurs moyens, qui sont faibles, les jeunes écrivains s’approcher de ces formes suprêmes de l’art, qui sont autant au-dessus du roman que le roman est au-dessus du feuilleton. A côté d’activités plus applaudies, il y a peut-être place (comme il reste, malgré tout, place pour la poésie) pour des activités secrètes. Ou sans cela, prenons garde.
Non que je veuille forcer ceux qui n’en ont aucune envie de publier une épopée sur Charlemagne, ou de mettre en alexandrins l’histoire de Sophonisbe. Mais il me semble qu’il est urgent de créer un état d’esprit favorable à de telles besognes saugrenues. Les mauvais poèmes et les mauvaises tragédies ont leur utilité : si l’on n’avait point inventé cette forme d’art, si chaque années des écrivains sans talent n’avaient pas mis en scène, à l’aide de confidentes enrhumées et de rois débonnaires ou furieux, les catastrophes les plus célèbres de l’antiquité païenne ou judaïque, jamais Corneille ni Racine n’auraient eu l’idée d’écrire leurs chefs-d’œuvre. Les mauvais écrivains aident à la venue des grands.
Et sans doute aujourd’hui, quelques isolés puisent-ils en eux-mêmes, assez de force pour maintenir l’existence des genres menacés. Au théâtre du moins. Car Claudel écrit des tragédies, et la « Judith » de Giraudoux en est une. Mais il faudrait qu’autour des isolés, une autre troupe se formât. Il faudrait commencer un grand rassemblement autour des genres condamnés, des genres ridicules, afin de les sauver, et par là de sauver en même temps bien des vertus essentielles. Une littérature est pauvre, une littérature est sans moëlle et sans force quand elle a pour grands hommes M. Mauriac ou M. Bernstein. Ces écrivains très estimables doivent être remis à leur vraie place, qui, affirmons-le, est secondaire.
Certes, on ne fait pas naître les chefs-d’œuvre sur commande. Pour la plupart des gens, l’idée qu’un roman de M. Mauriac vaut mieux qu’une mauvaise tragédie est une proposition de bon sens. Ils ont raison, mais, sous un certain aspect, on peut dire qu’il vaut mieux pour une littérature produire de mauvaises tragédies que de bons romans secondaires. La hiérarchie des genres est une vérité, entre tant d’autres, que nous avons oubliée, et qui nous paraît même intensément ridicule. Il y a pourtant une hiérarchie des genres, et l’homme dont nous ayons peut-être le plus besoin, c’est d’un Boileau. Un Boileau qui nous apprendra son pesant et son étroit « Art Poétique ». Quand on songe que Flaubert en écrivant « Madame Bovary », a voulu refaire « Don Quichotte », on ne mesure que mieux ce qui s’est perdu d’une œuvre à l’autre. Ce qui ‘est perdu, c’est ce qu’il s’agit de retrouver.
Aussi, s’il est un vœu que je forme de toutes mes forces, c’est celui de voir aider, dans la mesure du possible, la résurrection des vertus essentielles dont nous parlions. Il ne s’agit pas d’applaudir aux poétesses de province, aux vérificateurs de l’enseignement secondaire en mal de tragédies classiques. Il ne s’agit pas de nous faire d’illusions. Et ce n’est pas en copiant servilement qu’on prolonge un art, mais en le revivifiant en soi-même. Seulement, encore faut-il que quelques conditions soient réunies pour cette prolongation et cette résurrection.
Sans rien oublier des autres soucis, légitimés par les circonstances, il serait bon que les jeunes revues devinssent les témoins et mieux que les témoins, d’un tel travail, c’est à elles à nous apprendre qu’il est des genres littéraires nobles, et disparus, qui valent aussi bien, qui valent mieux que le roman et l’essai politique. Ainsi peut-être pourront, être préparés le chemin à ceux dont la vocation est d’avance découragée par notre temps et par ses préjugés.
Robert BRASILLACH.
(Combat, février 1936.)