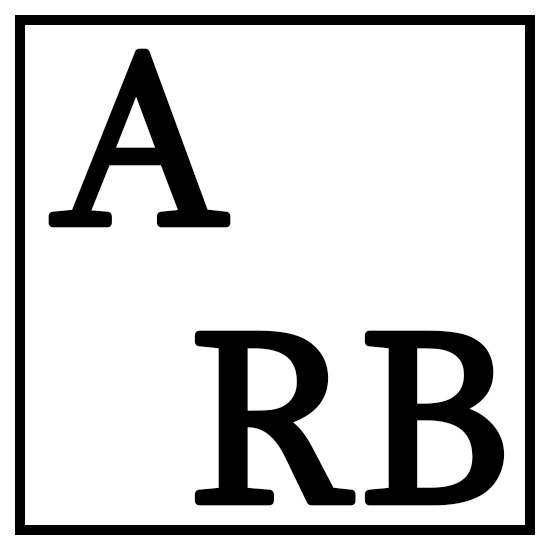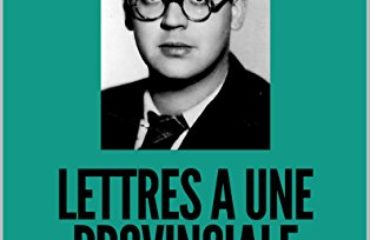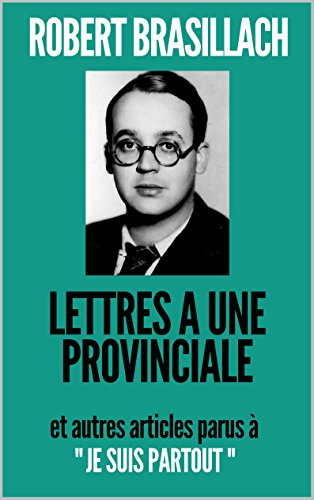
Pour une de vos amies qui a un grand fils, ma chère Angèle, vous me demandez des renseignements sur la Cité Universitaire : est-il vrai que la grève sur le tas y est organisée en permanence, que le restaurant est vide et que de farouches miliciens en défendent l’entrée? Rassurez-vous, ma chère amie, vous êtes en retard de quelques semaines, ou peut-être en avance de quelques jours. La grève du restaurant de la Cité est provisoirement terminée, mais, à ce qu’on m’a dit, pourrait reprendre d’ici peu. Je dois avouer que, pour ma part, elle m’a fort réjoui. J’ai passé une année, il n’y a pas si longtemps, à la Cité Universitaire, et je n’en ai pas gardé mauvais souvenir. C’est un lieu mythologique, ma chère Angèle, une foire de la jeunesse, abritée dans des pavillons d’Exposition universelle, de fragiles pavillons dont on s’étonne qu’ils ne tremblent pas au vent, déjà un peu usés, un peu abîmés, parce qu’ils n’avaient pas tous été construits pour durer. Il y a un charme délicieux dans ces pelouses, ces baroques maisons alsaciennes noyées de lierre, ces Parthénons et ces châteaux à demi ridicules. Soyez assurée que je n’ai rien contre la Cité, encore moins contre les donateurs qui ont eu l’idée charmante de construire, aux abords de Montsouris, ces abris éphémères et ravissants pour le peuple éphémère de la jeunesse. Peut-être ne savez-vous pas qui est M. Honnorat, ma chère Angèle ? Je ne sais pas grand-chose de lui non plus, mais je serais peiné si l’on me prouvait que ce ministre oublié fut autre chose qu’un grand poète : car il a inventé la Cité Universitaire et imaginé, par l’heure d’été, de nous donner dans les beaux mois de longues et pures soirées.
Mais je crois bien que la Cité Universitaire est aussi, pour des esprits moins sensibles au charme immédiat de l’heure, un exemple éminent des lois de dégradation qui régissent notre univers. Peut-être y avait-il sur ces berceaux de mauvaises fées. Je le croirais assez volontiers si je pense qu’on a tout fait, ou à peu près, pour qu’une oeuvre si noble ne fût pas viable. On n’a pas compris que disjoindre le travail et le repos sans certaines conditions était une absurdité, et qu’il était ridicule de vouloir faire habiter les étudiants si loin des lieux où ils travaillent. A tout le moins, puisqu’on ne pouvait transporter le Quartier Latin tout entier dans les parcs et les terrains aérés de Montsouris, il était ridicule de ne pas organiser ces moyens de transport rapides qui, aujourd’hui, rapprochent si aisément deux lieux. Un seul autobus, tous les quarts d’heure, réunit la Cité et le Quartier Latin. Habilement, on s’est arrangé pour que ce parcours comporte deux « sections » au lieu d’une. A huit heures du soir, son trafic s’interrompt. Il est toujours en retard : l’autre soir, ma chère Angèle, après une demi-heure d’attente, on m’a dit qu’il s’était perdu dans Arcueil. Comme cela est admirablement français !
Aussi, ma chère Angèle, la Cité n’a-t-elle point d’âme. Aux temps bienheureux où les étrangers affluaient à Paris, où les chambres coûtaient au Quartier Latin des prix astronomiques, on refusait huit cents demandes par an. Aujourd’hui, les étrangers sont partis, les chambres du Quartier ont baissé leurs prix, celles de la Cité ont augmenté. Qui est assez riche pour payer quatre cents francs un logis dans un pavillon étranger ? Avec les frais de communication ? Et même pour les cités françaises, êtes-vous sûre que les étudiants ne préfèrent pas un hôtel, même inconfortable, plus près de leur travail, de leurs plaisirs, de leurs cafés ? Il y a des avantages à la Cité, mais ce ne sont point ceux auxquels tient la jeunesse française : car c’est surtout un certain confort. Et, de jour en jour, la Cité se vide. Ceux qui y habitent encore se contentent d’y coucher et n’y apparaissent pas de toute la journée. On doit, hélas ! faire du racolage.
Y dînent-ils ? La grève du restaurant vous a appris, ma chère Angèle, qu’ils n’étaient pas contents. Jadis, le restaurant était logé dans un hangar en bois fort pittoresque. Aujourd’hui, dans la somptueuse Maison Internationale, ses salles voûtées imitent tant bien que mal le réfectoire de couvent. Ce n’est pas très gai, et, pour ma part, je préfère les restaurants russes de la rue Royer-Collard, qui, pour sept francs, vous donnent des fleurs, un orchestre, des petites tables et l’illusion d’un luxe naïf. Au moins, à la Cité, les prix sont-ils bas? Hélas, ma chère Angèle, ils sont élevés pour des étudiants. Je ne dis pas que déjeuner pour huit francs soit cher, mais qu’on ne me prétende pas qu’il s’agit là d’une institution philanthropique, puisqu’il ne manque pas de restaurants à meilleur compte. La nourriture y est fort mauvaise, disons-le tout net, et il n’y a pas d’organisation plus défectueuse que celle-là. Un petit fait vous dépeindra mieux que tout autre la très probable hypocrisie qui préside à cette organisation. On vient d’ouvrir une salle de réunion, dans la Maison Internationale. J’y ai pris un café, d’ailleurs honnête. La règle, comme partout, est qu’on se sert au comptoir, qu’on ne donne pas de pourboire et que la maison ne fait pas de bénéfices. Ce café coûte douze sous. Mais pourquoi tant de bistros, qui n’ont pas fait voeu de charité, que je sache, donnent-ils le leur, au Quartier Latin et ailleurs, pour dix sous, pour huit sous, voire pour sept? Il faut bien qu’ils y gagnent, pourtant.
Ne vous étonnez pas, ma chère Angèle, si les étudiants de la Cité Universitaire demeurent insensibles à tant de belles phrases sur le rapprochement des peuples et sur l’aide apportée aux travailleurs intellectuels. Cette aide existe, ou a existé, et je ne vous écris point cela pour diminuer le rôle, d’ailleurs admirable, de ceux qui ont fondé la Cité et qui, chaque année encore, font construire de nouveaux pavillons, défrichent la zone, préparent un parc de sports. Mais, malgré tout, ils ne peuvent tout faire, et l’Etat reste le grand responsable. Un contrôle un peu plus sévère ferait assurément du restaurant autre chose que l’indécente gargote qu’il est, à des prix que tous les étudiants trouvent trop élevés. Une organisation plus intelligente réclamerait à la T.C.R.P. des autobus rapides, pratiques, économiques et qui ne se perdent pas.
Peut-être pour cela, ma chère Angèle, faudrait-il aimer la jeunesse, faudrait-il croire en elle. La Cité ne peut pas vivre en France, malgré le parc, l’air pur, les constructions dérisoires et charmantes, parce que la France est un pays de vieux. On ne veut pas voir l’avenir, on ne veut pas voir les conséquences, et les meilleures idées deviennent de pauvres inventions. Tant que cet état d’esprit n’aura pas changé, la Cité Universitaire sera une ville morte, ravissante mais déserte, dans un pays brumeux, l’ultima Thulé de l’enseignement, au bord d’un no man’s land si effrayant que les autobus se perdent pour y arriver.
Je Suis Partout, Lettre à une provinciale, 26 décembre 1936